LETTRE N° 51 : 15/09/2024 FÊTES, TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
A LIRE EN PAGE 2
Il existe actuellement une multiplicité de bizarreries, que ce soit dans les domaines politique, économique ou social. Je ne prendrai ici qu’un seul exemple. Par arrêté municipal qui se renouvelle tous les ans en période estivale, depuis le 8 juillet 2020, le maire de Canet-en-Roussillon demande de faire cesser, à partir de minuit, toutes les formes de nuisances sonores (musique ou autres) qui sont diffusées dans la ville. De ce fait, certaines dérogations de dépassement d’horaires ont été supprimées. Pourtant, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024, « par autorisation à titre exceptionnel du maire » de cette commune, une entreprise locale, pour laquelle un bâtiment public a été mis à disposition, a allègrement franchi le seuil des décibels jusqu’à quatre heures du matin. En conséquence, voilà un élu local attentif au repos des habitants et à la quiétude des lieux, et qui dans le même élan ne se soucie ni de l’un ni de l’autre. Que peut-on alors penser de cet exemple qui, pour être cocasse, n’en est pas moins surprenant (pour qui, bien sûr, veut être surpris) ?
On doit admettre que nous sommes dans une société où le bruit est omniprésent. Il semble dès lors très difficile d’en réduire l’ampleur. Tout crée du bruit : les voitures, les trains, les bus, les avions, sans compter les usines, sans oublier la musique d’ambiance dans tous les commerces et les rues, ainsi que les débroussailleuses, les marteaux-piqueurs, les perceuses, ou les souffleurs pour déplacer des feuilles... Alors, pour effacer tout ce bruit, il suffira de mettre des écouteurs, monter le son et se dire que la musique adoucit les mœurs. Voilà notre univers machiniste qui depuis plusieurs siècles semble honnir le calme et assimile le silence à l’immobilité, voire à la mort.
Mais revenons à notre exemple. On sait qu’il existe de très nombreux textes relatifs aux bruits et à leurs conséquences. Parmi ceux-ci, on peut citer l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, modifié par décret en 2017, qui précise notamment les seuils et les valeurs limites d’un bruit. Pourquoi alors le maire serait-il amené à signer un arrêté ? La réponse semble assez simple. Le but ne serait-il pas de faire sa propre publicité et dire « je m’occupe de vous » ? Enfin, nous pourrions nous interroger sur cette étrange « autorisation à titre exceptionnel » qui est en complète contradiction avec les lois et l’arrêté. Sommes-nous en démocratie, lorsqu’une seule personne s’arroge le droit de privilégier un de ses administrés en lui donnant l’autorisation de déroger aux règles établies ? Ne sommes-nous pas revenus plutôt au temps des fiefs, où le seigneur avait tout pouvoir sur ses vassaux ?
En définitive, si notre exemple est singulier, il n’est qu’à l’image du monde contemporain, chargé de paradoxes et de contradictions. Certes, cela n’est pas très nouveau, mais cela semble s’amplifier nettement. On veut du calme mais on fait du bruit. On veut protéger la nature mais on la défigure. On veut la paix et on fait la guerre. On met en exergue le partage et on valorise la concurrence. On souhaite se déplacer en tous sens mais on pose des barrières et des frontières. On veut la démocratie et on en appelle à l’autoritarisme. Et j’en passe… Or, à force d’osciller sans cesse de cette manière, tout le monde est en passe de devenir schizophrène, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais alors le risque majeur n’est-il pas surtout de devenir la proie de tous les bonimenteurs qui s’empressent sur la place publique et dans les médias ? À moins que cela ne soit déjà le cas.
BIENVENUE SUR LE SITE
DE L'ASSOCIATION PEAL
Chargée d’étude :
Corinne Berger : Juriste
Nathalie Chabaud : Psychologue
Yves de Ribaupierre : Physiologiste
Jean-Luc Roques : Sociologue
Rémy Roussille : Occitaniste
Catherine Meyer (USA) : Linguiste
NOUVEAU LIVRE
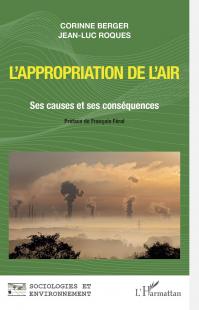 Corinne Berger, Jean-Luc Roques
Corinne Berger, Jean-Luc Roques
L'APPROPRIATION DE L'AIR
…Ses causes et ses conséquences
Préface de François Féral
Est-il possible de s’approprier l’air ? En répondant par l’affirmative à cette question, ce livre montre comment se concrétise une telle captation.
Les données indiquent que l’air est malmené. Le monde reste en attente, alors que la situation est dramatique. Quelles sont alors les conséquences d’une telle inertie ?
D’abord, en insistant sur sa rareté, l’air est transformé en objet marchand. Il devient objet de convoitise, pour les marchés boursiers, les industries. La phobie du mauvais air implique aussi de s’en protéger. L’air sain devient source d’accaparement commercial, à travers la publicité. Mais, il ne faut pas omettre la récupération qu’en font les doctrines identitaires.
L’air, ainsi dégradé, génère des phénomènes d’appropriation qui ne présagent rien de bon pour l’avenir.
__________________________________________________
Projets et Etudes en Atelier Local (PEAL)
9 rue Benjamin Franklin 66000 Perpignan Courriel
Créée en 1992 avec pour objet de réaliser des études en sciences sociales et humaines, l’association (Projet et Étude en Atelier Local) adopte le principe de travailler systématiquement par ateliers de réflexions.
Soucieuse des questions liées à l’environnement, elle concentre aujourd’hui toute son action autour de cette thématique.
Tout le monde semble d’accord sur le fait qu’il est impératif de préserver les milieux et les espaces, tout en laissant la pollution des sols gagner du terrain. Tout le monde semble d’accord pour promouvoir des mesures en matière d’urbanisme, tout en laissant faire le marché de l’immobilier.
Tout le monde semble soucieux de garantir la santé des populations contre la dégradation atmosphérique, tout en fermant les yeux sur les industries polluantes. Tout le monde s’accorde pour affirmer qu’il faut transformer les choses, sans véritablement vouloir les modifier.
Dans ce contexte, des voix s’élèvent pour envisager de considérer l’environnement et ses composants comme devant relever du patrimoine mondial. Mais dans le même temps, les territoires, nationaux, régionaux ou locaux, revendiquent la gestion unilatérale de leurs espaces. Toutes les actions semblent alors buter sur un ordre territorial qui se veut tout-puissant. On voit avec stupeur que, malgré les divers appels et certaines prises de conscience, rien ne semble changer.
La situation continue à empirer lentement mais sûrement. On peut être agacé par ces contradictions, mais les faits sont là bien présents, face à nous. Tout le monde se met des œillères et évite d’envisager le pire. Ceux qui le peuvent se referment sur un quant-à-soi, un espace propre et sécurisant. Ainsi, comme l’écrit Lascoumes avec grande clairvoyance « Dans les représentations communes, l’environnement est réduit à une notion égoïste et appropriative qui ne traite que de l’espace de vie immédiat en ramenant tout à lui ». Tout le monde s’intéresse alors à ce qui l’environne, mais en aucun
cas à l’environnement.
Laissez-nous vos commentaires en bas des pages " Lettre du PEAL" Bibliographie" et "Activités", directement sur le site, ou écrivez-nous :
Les éditions du Bousquet-Labarthe
site : http://lebousquetlabarthe.wix.com/editions

