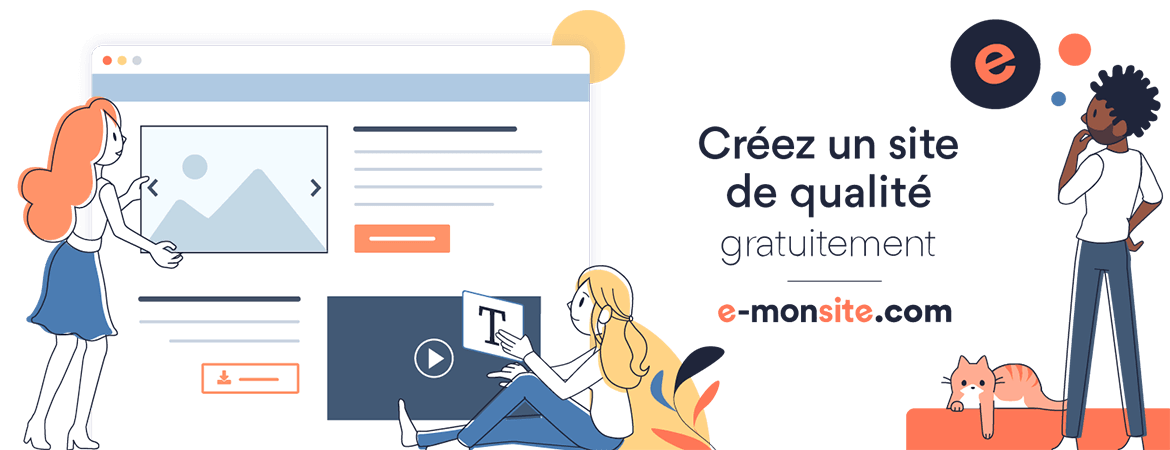LA LETTRE DU PEAL N° 50 : 15/06/2024
FÊTES, TEMPORALITÉS ET ENVIRONNEMENT
« Il était pratiquement impossible de se remémorer toutes les fêtes. Chaque journée était dédiée à quelque chose et les publicitaires s’efforçaient de donner à ces différents événements un relief comparable à Noël. Les associations reliées à l’objet de la fête étaient mobilisées et les devantures s’ornaient de produits célébrant la même occasion. »
Jean-Christophe Rufin, Globalia.
Alors que les fêtes sont considérées comme plutôt joyeuses, il en existe de plus tristes. Elles ne sont donc pas toutes semblables. De plus, certaines sont tournées vers le cérémoniel, d’autres plutôt vers le divertissement. Les unes peuvent rassembler quelques individus, comme des membres de la famille ou des amis, d’autres vont unir dans un même instant des milliers de personnes. Elles peuvent être d’obédience religieuse, politique ou culturelle... Il y a, à n’en pas douter, autant de types de fêtes que de situations et de groupes humains. Toutefois, comme le relatait la Lettre précédente (voir archives, Lettre n° 49), les fêtes semblent aujourd’hui happées, pour une bonne part, par le commerce et le calcul marchand. Cela signifie que, quelles que soient leurs formes, elles doivent être économiquement rentables et lucratives. Donc, si « le temps c’est de l’argent », comme le soutenait, à son époque, Benjamin Franklin, les fêtes doivent l’être aussi. Mais alors, quel en est le prix pour l’environnement ?
Revenons tout d’abord sur quelques changements d’état d’esprit relatifs à ces événements festifs. Pour certains anthropologues traitant des sociétés traditionnelles, la fête, notamment dans sa phase exubérante, participait au retour mythique aux origines et au temps primordial. Roger Caillois y voyait une réactualisation du chaos originel, qui permettait en quelque sorte de reproduire l’acte de création et de revisiter la jeunesse du monde. L’ordre pouvait ainsi être régénéré. Le temps de la fête était donc extratemporel. À la différence de la quotidienneté, cet instant simulait l’éternité. La fête devenait une célébration symbolique qui renvoyait à des événements du passé, à des hommes ou des dieux, à des phénomènes cosmiques et bien d’autres éléments ou phénomènes. Considérons que, pour partie, la fête relevait d’une relation typique à la nature et à ses grands cycles. Par exemple, dans certains rites matrimoniaux anciens, l’union festive reproduisait le lien entre la Terre (qui représentait la femme) et le Ciel (qui représentait l’homme). Les fêtes pouvaient être dédiées aux éléments fondamentaux, comme l’eau, la terre, le feu ou l’air, et à diverses cosmologies. Mircea Eliade montrait que, dans la plupart des sociétés primitives, la nouvelle année équivalait à la levée du tabou de la nouvelle récolte, alors proclamée comestible et inoffensive. Au printemps, dans la tradition slave, on fêtait les déesses de l’eau et, dans d’autres lieux, on invoquait l’œuf qui sortait de la terre. D’autres fêtes encore portaient sur le caractère ascensionnel de l’air. Enfin, celle des moissons symbolisait le feu. Ces rencontres étaient donc des événements importants et réguliers. Dans la Rome antique, quarante-cinq d’entre elles relevaient du religieux, et soixante de jeux publics. Au Moyen Âge, les fêtes pouvaient se renouveler tous les trois jours. Or, progressivement et sous les coups de boutoir de l’Église, pour qui danser, chanter et porter un masque étaient des péchés, puis de l’État, notamment lors de la Révolution française, le nombre de fêtes a été réduit. Il fallait soutenir le travail, la production et l’économie plutôt que les divertissements. Les réjouissances traditionnelles ont eu dès lors tendance à s’étioler. Cependant, comme les humains ne peuvent s’en passer, pour notamment se libérer de multiples pressions, se retrouver et s’unir, les fêtes ont perduré, mais leur orientation a changé. Dans la mesure où les fêtes n’ont plus beaucoup de liens avec la nature, ne s’en éloignent-elles pas définitivement ?
On peut noter que quelques fêtes marquent encore la survivance de traditions. C’est le cas de la fête de l’ours, celle de la Saint-Jean, des fêtes votives, de la fête du cochon ou de la saucisse... Or ne deviennent-elles pas que pur spectacle, ne relevant plus que du folklore, au service d’un tourisme friand de ce type d’événement ? Ainsi, de nouvelles fêtes se sont greffées sur un élément ancien, et d’autres, plus particulièrement en milieu urbain, ont été instaurées de manière totalement artificielle. La liste est très longue mais fait apparaître qu’elles deviennent, dans l’ensemble, tournées pour la plupart vers la seule consommation et permettent de stimuler celle-ci. La fête des mères, celles des pères ou des grands-mères, Noël ou les fêtes de fin d’année se mélangent au Black Friday, au Cyber Monday ou aux soldes, sans compter la fête des livres, celles des associations et des voisins, et bien d’autres. La fête de la fin des vendanges a été remplacée par la fête des vins dans les supermarchés. Nous avons là surtout la fête des produits et des biens, dont certains seront engloutis, d’autres oubliés, quand d’autres encore finiront dans une poubelle. Même la Toussaint n’a pas échappé au marché, où le culte du profit a sans nul doute supplanté la foi chrétienne, avec près de 21 millions de pots de chrysanthèmes achetés en France pour un montant total de 163 millions d’euros. Mais il faut ajouter à tout cela les salons et les foires, sans compter les vide-greniers, qui, au-delà des déchets à usage unique pour les stands, représentent un gaspillage alimentaire de plus de 15 % par rapport à la nourriture prévue. Mais attachons-nous à un fait particulier, celui des festivals de musique. Le journaliste Matthieu Balu montrait que les suites d’un festival à Reading, réunissant 90 000 personnes, présentaient une « véritable vision de cauchemar qui n’est que l’exemple habituel des lendemains de festival ». En effet, les plus grands festivals engendrent entre 80 et 100 tonnes de déchets. Mais, pour de plus petits festivals, les résultats ne sont pas bien meilleurs. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) estime qu’une manifestation de 5 000 personnes génère environ 2,5 tonnes de déchets. Cela représente l’équivalent de cinq années de déchets pour une seule personne en France. De plus, ce même type de manifestation consomme 1 000 kWh d’énergie. Cela équivaut globalement à la consommation électrique d’un ménage pendant trois mois. Tout cela ne peut donner qu’une image de vertige quant aux effets environnementaux, même si certaines fêtes tentent de renouer avec la nature et de sensibiliser les individus. Or ces dernières ne se conforment-elles pas aux mêmes stéréotypes que ceux de n’importe quelle fête commerciale, avec leurs stands et leurs équipements ? Si par exemple la fête de la nature en avril, créée en 2007 sur l’initiative du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), qui pendant cinq jours organise plus de 5 000 manifestations gratuites pour le public, ou le jour de la Terre au mois de mai ont un impact sur les opinions, on peut se demander quels sont leurs véritables effets sur les conduites et les comportements des individus.
Il n’est certainement pas question ici de faire l’éloge ou l’apologie d’un type de société et d’en dénigrer un autre, ni de mettre en exergue une quelconque forme d’austérité. L’idée est surtout de mettre en évidence les différences dans les rapports entre fêtes et environnement. Dans les sociétés traditionnelles, à forte dominante paysanne, il semble évident que le lien à la nature était sensible. De nombreuses fêtes y étaient d’ailleurs rattachées, pour en appeler à une bonne destinée ou pour conjurer les mauvais sorts. Les sociétés productivistes n’ont, quant à elles, tenu aucun compte de l’environnement dans lequel elles ont évolué. De manière concomitante, leurs fêtes, sauf marginalement, s’en sont aussi totalement détachées. Chaque système social et culturel exerce ainsi des pressions nettes sur les populations et impose des manières de penser et d’agir. On constate que, de nos jours, même si la liberté de l’individu est mise en avant, tout est construit paradoxalement pour que ce dernier n’en ait aucune. Tout semble méticuleusement construit pour l’orienter, le guider et le diriger vers des activités de production, de consommation de biens utiles ou totalement inutiles. La fête devient un bon moyen d’occupation de ce que l’on nomme curieusement le « temps libéré », mais surtout un instant privilégié pour assurer une consommation ostentatoire. Pour paraphraser George Orwell dans La Ferme des animaux, le slogan pourrait être : « Se dépenser c’est bien, dépenser c’est mieux. » Dans ce contexte, non seulement les fêtes n’ont plus, ou que peu, de liens avec l’environnement et la nature, mais leurs effets sont pour bon nombre d’entre elles délétères. Ainsi, lors de ces moments festifs, il est bien évident que les économies d’énergie, le tri sélectif et la réduction des déchets, l’alimentation équilibrée, voire le calme, la détente ou la sobriété sont très vite oubliés.
En conséquence, les fêtes deviennent un bon support commercial. Pour cela, le marché et le calcul économique ont tout intérêt non seulement à les démultiplier, à en inventer sans cesse de nouvelles, mais surtout à montrer qu’elles sont nécessaires et utiles. Pourtant, si l’on regarde du côté des effets environnementaux, les résultats ne semblent pas très probants. Ne devient-il pas indispensable de contester cette logique et d’aller un petit peu à contre-courant ?