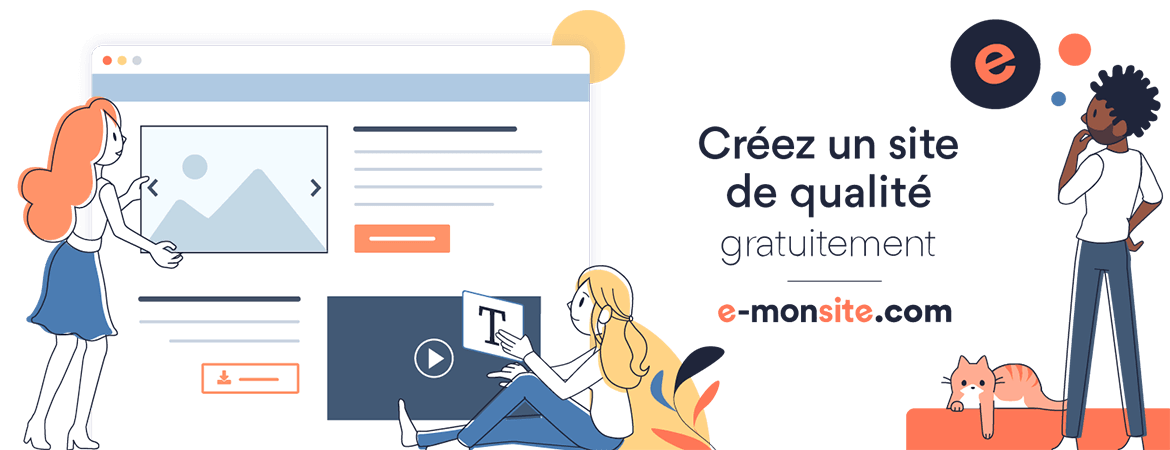Point de vue 1 : Janvier 2015
Ce 7 janvier 2015 restera, malheureusement, une date dans l'histoire de France : ce jour où la rédaction d'un journal fut décimée, ce jour où douze personnes, dont plusieurs dessinateurs de presse, furent lâchement massacrées. Et pas n'importe quel journal, Charlie Hebdo, journal de provocation, d'humour, de dérision, le tout basé sur la caricature, bref le journal symbole même de la liberté d'expression, de la liberté de presse, le journal du non politiquement correct.
Ce matin là, à 11h30, l'atroce réalité apparaît, un commando de deux individus abat douze personnes, en blesse onze autres, mais que se passe-t-il, dans quel monde vivons-nous ? Certains refuseraient-ils l'humour blasphématoire, et bien oui, certains sont élevés dans une rigidité d'esprit qui renie le second degré, qui renie l'humour. Mais certains aussi sont manipulés dans ce sens afin de servir d'instruments de guerre pour déstabiliser un pays, et c'est le cas de ces deux là, d'où cette froideur, cette organisation implacable, cette fuite relativement facile.
Tout ceci est-il explicable ? Sûrement le monde est devenu dangereux depuis la fin de la guerre froide, le monde est devenu dangereux depuis que les américains sont devenus les « gendarmes » du monde : montée des nationalismes, des populismes, montée du terrorisme, de la violence et toutes ces montées sont largement imbriquées les unes aux autres, les unes pouvant expliquer les autres et vice versa ! La société n'a-t-elle pas sombrée dans le fanatisme sous toutes ses formes, l'argent à tout prix, l'intégrisme religieux, les politiques inefficaces, la destruction de l'environnement...
Ne serait-il pas temps de se poser les bonnes questions et ne pas tomber dans la volonté de vengeance systématique, dans la recherche à tout va de boucs émissaires !
Les démocraties ont-elles atteint leur paroxysme, ne sont-elles plus capables de se défendre face à la haine, la violence, les politiques n'arrivent-elles plus à définir de manière irréfutable les libertés de presse, d'expression, de parole, la laïcité, enfin les démocraties n'ont-elles pas perdu de leur force, ne se sont-elles pas fourvoyées dans un flou didactique, ont-elles oublié la solidarité, l'égalité, le respect de l'humain, le combat contre tous les extrémismes (politiques, sociaux, religieux) ? Enfin, les démocraties n'ont-elles pas omis que l'essentiel pour une société avancée est l'éducation, la diversité, la culture, l'art...?
Ceci est une réflexion sans prétention qui permet d'évacuer un peu l'extrême tension, l'extrême traumatisme qu'engendrent de telles dérives humaines. Reste-t-il, après cela, un infime espoir dans la capacité de l'humanité à dépasser cette bassesse bestiale et à devenir enfin intelligente dans le sens raisonnable, capable de définir enfin le bien du mal dans le respect de l'humain en tant qu'être vivant dans un même bateau, la Terre ?
Pascale Berger.
Point de vue 2 : Mai 2015
À la fin des années 1940, on évoquait Paris et le désert français. Jean-François Gravier dans son livre célèbre écrivait : « Peut-on fonder l’avenir d’une nation sur l’hémorragie interne ? Peut-on fonder sa renaissance sur le gonflement congestif de 4 % de son territoire et sur l’appauvrissement continu [du reste] ? » Les pouvoirs, les corps d’État et les bonnes consciences approuvèrent le constat. Il fallait repenser l’espace national. Le temps a passé, mais aussi l’aménagement du territoire, les lois de décentralisation et les réformes territoriales. Le constat de 1947 a-t-il changé ?
Aujourd’hui, la tendance est à l’imposant, au colossal et le petit n’a qu’à bien se tenir ou mourir dans son coin sans faire de bruit. Ce n’est plus la Nation mais les grandes régions qui deviennent la panacée universelle avec comme moteur, des métropoles puissantes, prêtes, nous dit-on, à rivaliser avec le reste du monde. Tout est fondé sur la concurrence, et l’efficacité ne peut venir, nous dit-on, que de la concentration urbaine. De plus, ces aires métropolitaines, en lien les unes avec les autres, pourront évidemment proposer à leurs élites et leurs édiles de rejoindre (et de se rejoindre), à grande vitesse, la capitale, centre de tous les savoirs. Marseille n’est plus qu’à environ 3h00 de Paris et bientôt Bordeaux n’en sera qu’à 2h00. Bien entendu, le temps c’est de l’argent. On remarque que le constat d’après guerre n’a pas été modifié, il s’est déplacé et a changé d’échelle. Du jacobinisme, nous sommes revenus aux baronnies.
En l’absence de vases communicants, les aires urbaines deviennent hypertrophiées et difformes, entrecoupées de routes, de ponts, de zones commerciales, artisanales ou industrielles. Vive le gros, vive l’obèse ! Pensées en haut lieu, elles font naître d’une part des centres où quelques décideurs se concertent, et d’autre part sur leurs marges des périphéries, mais aussi des zones beaucoup plus éloignées. Cette situation devient dramatique pour ceux qui sont mis aux bans, comme pour ceux qui s’installent aux franges des zones rurales moins bien équipées, et moins bien desservies. Pour ces derniers, à termes le vieillissement entraînera inexorablement des problèmes aigus d’isolement notamment pour les plus pauvres d’entre eux. Mais qui s’en soucie ?
Si les métropoles s’enorgueillissent de la venue de population, et peuvent pérorer sur leur attractivité, d’autres espaces en revanche se vident totalement ou presque, devenant des villes, des villages ou des bourgs fantômes. Des espaces entiers meurent, du départ de leurs habitants, de leurs commerces et de leurs services publics. Sinistrés, plombés par les crises ces territoires sont laissés à l’abandon. Mais en définitive, ils ont toujours posé un problème aux aménageurs et aux politiques. D’ailleurs dans divers pays, la question de leur évacuation totale en raison de leurs coûts a été de manière récurrente mise à l’ordre du jour. Au-delà, ce qui en ressort est une impression d’espaces laissés à la dérive, parfois ici ou là parsemés de soubresauts dérisoires. Ce n’est plus Paris et le désert français mais bien les métropoles et leurs lointaines périphéries entièrement détruites, sur l’autel de la modernité, de la rentabilité, et du sacro-saint aménagement de l’espace.
Jean-Luc Roques.
Point de vue 3 : Septembre 2015
La fusion de communes consiste en la création d’une « commune nouvelle » par réunion de plusieurs entités préexistantes. Cette politique de fusion pendant longtemps a eu pour principal objectif d’éviter l’éclatement d’espaces en de multiples entités. Aujourd’hui, même si les communes de moins de 500 habitants représentent encore 54 % de l’ensemble des communes françaises, l’incitation aux regroupements vise plutôt une économie d’échelle. Il faut bien souligner que le législateur a toujours été l’instigateur de la démarche et que cette formule est empreinte de la toute puissance de l’État. Partant de là, comment peut-on expliquer l’attitude des communes face à cette politique ?
Petit rappel historique : la Constitution de l’An III impose la fusion par la création de « municipalités de canton » ; pendant le Consulat, ce sont 6 000 petites communes rurales qui fusionneront. Sous le gouvernement de Vichy, la loi du 28 février 1942 prévoyant la fusion systématique des petites communes rurales est promulguée, mais restera sans suite. La Ve République relance la politique de fusion, notamment par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 dite « loi Marcellin ». La principale originalité de cette loi était d’ajouter à la « fusion simple », une formule nouvelle – jugée plus attrayante – la « fusion avec communes associées ». Les élus avaient le choix entre la disparition complète de la commune d’origine ou la subsistance de certaines formes de la vie communale ancienne, comportant des annexes de la mairie et des maires délégués. Malgré cela, seulement 775 communes vont fusionner. Le constat est donc lourd, c’est un échec. Les petites communes rurales feraient-elles de la résistance vis-à-vis du pouvoir central ? Elles revendiquent surtout leur identité et leur autonomie.
Le contexte actuel : les communes préfèrent une formule plus souple qui leur permet de préserver leurs particularismes locaux. Elles choisissent de se regrouper dans des syndicats (SIVOM ou autres syndicats intercommunaux). Le problème du millefeuille territorial va alors se poser, s’ajoutant à cela celui de l’intercommunalité. Actuellement, il est possible de créer une commune nouvelle se substituant à l’ensemble des membres d’un EPCI, mais ce sont plutôt des communautés de communes qui se regroupent entre elles sans pour autant basculer dans la fusion de communes. Aussi, d’ici 2020, les conseillers des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes auront des compétences obligatoires, comme la gestion de l’eau ou des déchets ménagers. Insidieusement, ce sont donc ces regroupements qui pas à pas constituent une menace pour la commune rurale. Il existe bien des petites entités isolées qui luttent contre la tentation de la coopération, mais en ont-elles les moyens et pour combien de temps encore ?
La solution à adopter : la loi du 16 mars 2015 sur les communes nouvelles, sorte de second souffle, peut venir à la rescousse de ces collectivités qui n’auraient pas pris le train en marche. Alors que l’intercommunalité trace sa route, il semble que la fusion de « petites communes rurales » dans un dernier soubresaut s’avère dérisoire. Craignant surtout d’être absorbées, ces communes s’associent dans la contrainte mais sans véritable projet de territoire. Et c’est ici que le bas blesse. Par-delà la commune, c’est aussi la proximité de l’usager du service public qui est en jeu. L’alternative serait la création de « Maisons de services au public », ersatz de communes. La disparition probable du service public véritable, en sera l’aboutissement.
On voit par là qu’un train en cache un autre, celui de la paupérisation des moyens de la puissance publique. La fusion ne vise dès lors qu’un objectif, un cumul des finances déjà fortement affaiblies.
Corinne Berger.
Point de vue 4 : Décembre 2015
La fusion des territoires est à l’ordre du jour pour des considérations politiques ou économiques. Refonte des régions, des intercommunalités, des communes. Les atouts de la fusion, qui sont invoqués le plus souvent, sont de regrouper des espaces autour d’un projet commun, afin que cette nouvelle structure soit plus efficace, plus efficiente, plus pertinente et plus cohérente. Cependant, cela ne pose-t-il pas un problème de sensibilité, mais aussi d’identité ? Les Bretons sont inquiets, les lorrains sont tourmentés, les habitants du Languedoc-Roussillon sont insatisfaits. Comment va-t-on appeler la nouvelle région, ou la nouvelle commune ? Certains se sentent perdus : « Moi, je suis Auvergnat 100 % et je tiens à le rester » dira un habitant de Clermont-Ferrand. Fusionner des territoires est sur le papier assez facile, mais beaucoup plus délicat dans la réalité.
Prenons un exemple banal mais assez typique de ce phénomène. Dans une petite commune, comme il en existe une multitude en France, environ 250 personnes sont inscrites sur les listes électorales, et une centaine y vit à l’année. En novembre 2015, une consultation de la population a été proposée par la municipalité. La question était de savoir si « oui » ou « non » la commune devait fusionner avec deux autres villages limitrophes comprenant chacun d’eux à peu près 150 habitants. L’objectif était de réunir les trois entités et de former une « nouvelle commune », dont la population totale atteindrait globalement plus de 500 individus. Le projet était conçu ainsi, mais surtout il permettait d’obtenir à l’avenir le maintien de diverses dotations. En amont, les édiles des trois communes s’étaient réunis pour statuer sur une charte d’union. Une période transitoire était aussi instituée, si le « oui » était majoritaire, jusqu’en 2020, date à laquelle la nouvelle commune devait se substituer aux trois entités initiales. Il est important ici de préciser que ces communes sont limitrophes, que les personnes y vivant à l’année sont natives des lieux, et que leurs parents ou leurs grands-parents sont également originaires de l’une de ces communes. Il n’y a donc a priori aucune tension, ni conflit, ni heurt entre ces trois territoires.
Au soir de la consultation, après une mobilisation relativement importante, plus des deux tiers des votants s’opposent à la fusion. On peut, dès lors, s’interroger sur les raisons qui ont pu motiver les habitants de cette commune à voter majoritairement « non ». Une première explication est que le maire n’aurait pas suffisamment montré à ses électeurs les raisons de ce choix. Obtenir plus de dotations, si la fusion était effective avant le 31 décembre 2015, n’était sans doute pas suffisant bien qu’elle fût la justification principale. En écoutant, les habitants de la commune, on peut constater qu’il existe ici d’autres motifs à ce refus. Voici ce qu’il ressort de quelques phrases assez symptomatiques. Un habitant dira : « On est en France, on ne va pas se mêler à des étrangers ». Dans plusieurs autres cas, il était admis que « les communes voisines étaient là pour profiter de leur argent ». Même localement avec des habitants qui se connaissent, sont voisins, les crispations sont bien présentes. On peut se demander alors comment unir des territoires plus vastes ?
Mais, en définitive ce qui apparaît comme étant le comble de cette histoire, est que le maire, porteur du projet de fusion, ayant dépensé son énergie et son temps, remercia la population, à la fois pour sa mobilisation, ce qui semble logique en démocratie, mais il remercia également les participants pour leur position alors même que celle-ci allait à l’encontre de ses vœux. N’était-il pas inconsciemment satisfait de cette résistance ? Et dans ce cas là, pour qu’elle raison ? Cela nous échappe, il faut bien le dire !
Jean-Luc Roques
Point de vue 5 : Février 2016
Le 24 Octobre 2015, nous manifestions au « Clapàs »(1) en faveur des « langues régionales. » La plupart d’entre elles, dont l'Occitan, sont en voie d’extinction selon un rapport de l’UNESCO. Pourtant inscrites au titre de l'article 75-1 de la Constitution le 23 juillet 2008, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, c’est tout le contraire, le pire se produit. Petit retour historique de batailles politico juridiques.
Depuis Juin 1992, des amendements relatifs à la reconnaissance des langues régionales, présentés par des députés et des sénateurs de droite, gauche et centre sont déposés et rejetés. Ainsi, N. Mamère, J.-J. Urvoas et F. Bayrou virent refusée leur proposition d’inclure cette reconnaissance au sein de l’article 2 de la Constitution qui stipule que le français (et lui seul) est la langue de la République. Cette inclusion eu égard aux langues régionales, ne figurait même pas dans le projet initial déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 23 Avril 2008. Adopté en deuxième lecture, mais levant toute ambiguïté relative à la primauté du français, l’absence de nouveaux droits pour ses locuteurs, la non obligation de ratifier la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires, la consécration de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, il est proposé d’introduire la mention de l’appartenance des langues régionales au patrimoine national au sein du titre de la Constitution relatif aux collectivités territoriales déjouant ainsi la pression de l'Académie Française le 12 Juin, qui demandait « le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s’exprimer ailleurs, mais qui n’a pas sa place dans la Constitution. » Automne 2010, le Mouvement Républicain de Salut Public demandait le retrait de la signalétique en occitan de Villeneuve-lès-Maguelone, Vilanòva-de-Magalona. Le juge du tribunal administratif invoquait un manquement à la sécurité routière, mais surtout une absence de fondement historique occitane de la dite appellation, et ceci malgré les travaux de J. Boisgontier, linguiste, certifiant que dans l’Histoire, toutes les 343 communes d’Hérault ont eu un nom occitan. Le 7 Décembre 2010, nouvelle proposition de loi relative aux langues et cultures régionales, par le rapporteur A. Jung et tout dernièrement le rapport P. Molac, ce 14 janvier 2016, qui a déclenché une réaction très étonnante de J.-L. Laurent sur son blog : « Langues régionales : bienvenue chez les dingues. » Petit rappel, A. Jung est alsacien et socialiste, P. Molac est breton et écologiste.
En conclusion, je vous livre les propos de X. North, délégué général à la langue française et aux langues de France, en Février 2010. L’arsenal juridique français sur ce sujet étant très riche, une nouvelle loi sur les langues régionales n’est pas forcément nécessaire. Il suffirait que l’on utilise de manière plus volontariste celles qui existent. C’est le sens de la réponse que E. Besson a adressée à l’Assemblée nationale à la députée M. Faure : « La conviction du ministre de la culture et de la communication est que le cadre législatif laisse d’importantes marges de manœuvre qui ne sont pas toujours exploitées. C’est pourquoi le gouvernement s’interroge sur la pertinence d’une intervention législative supplémentaire ». Cette manifestation du 24 Octobre 2015, organisée par un collectif d’associations revendiquait inlassablement depuis 2005 la création d’une LOI capable de garantir la pérennité de ces langues de France, évidemment sans que soit mis en danger le français et la République française, ce dont doute une part importante d’élus en brandissant le phénomène Catalan. Occitaniste, je ne m’engagerai pas à demander un référendum en faveur de l’indépendance de l’Occitanie, je ne suis pas dingue!
Rémy Roussille.
(1) Lo Clapàs, nom occitan de Montpellier, toponyme que l'on trouve aussi dans Méjannes-le-Clap.
Point de vue 6 : Juin 2016
Auparavant, il y avait des cultivateurs, des forgerons, des charpentiers, des tailleuses en robes, des blanchisseuses, des gardes-champêtres, des escompteurs, des cafetiers. Chacun paraissait être à sa place et chacun avait un statut avec des compétences précises. Actuellement, des individus sont statutaires ou contractuels, à temps complet ou à temps partiel, d’autres sont en contrat à durée déterminée ou indéterminée, micro-entrepreneurs ou salariés, intermittents du spectacle ou intérimaires, et tout ce petit monde semble chercher sa place.
On se rappelle du livre « Les raisins de la colère » de John Steinbeck en 1939, qui parlait des miséreux ayant traversés les Etats-Unis et venant vendre leur force de travail à moindre coût pour de riches propriétaires fonciers ou exploitants agricoles. On se souvient également que dès le 19ème siècle, des ouvriers se sont battus pour obtenir des droits sociaux, impensables auparavant. Ainsi, grâce à ces luttes, les travailleurs ont obtenu le droit de faire grève, les congés payés, ou encore un salaire décent. Des lois ont permis, par la suite, de créer la Sécurité Sociale, d’interdire le travail des enfants et de diminuer la durée légale du travail. Or, aujourd’hui, dans un univers de précarités, on peut se demander à qui profite ces droits ?
Avant de répondre à cette question, toute la difficulté est de savoir de quoi l’on parle s’agissant du travail. Prenons la structure qui le concerne, elle peut être une coopérative, un établissement public, une collectivité, une association ou un atelier, mais peu importe finalement, car ce qui priment dans l’organisation, ce sont les règles qui la régissent. Le travail s’établit d’abord à partir d’une relation asymétrique. D’un point de vue purement juridique, deux personnes sont liées par un contrat de travail lorsqu’on a d’un côté, l’employeur et de l’autre, son subordonné. Ce contrat se distingue en effet des autres conventions de droit public ou privé, justement par cette caractéristique ou ce lien de subordination. Le travail est avant tout un contrat, oral ou écrit, avec un supérieur hiérarchique ; le poste de travail, le lieu où il doit s’accomplir, des horaires, un emploi du temps, des tâches ainsi que le temps d’exécution y sont précisés.
Le travail s’effectue donc sous la contrainte mais il a aussi, et fort heureusement, quelques avantages. La rémunération, par exemple, est un élément essentiel du contrat de travail. Prenons le cas du salariat, ici le salaire brut sera composé de charges obligatoires qui couvriront la maladie, l’accident du travail, les allocations familiales, le veuvage, le chômage, la formation et la retraite. Ces charges salariales et patronales représentent environ 45 % de la paye, le reste (ou le salaire net) sera perçu par l’employé. Et comme « Tout travail mérite salaire », il va sans dire que le travailleur ici, n’est certainement pas un agent bénévole. En tout état de cause, la rétribution peut être le moyen d’assurer son avenir.
Aussi, les lois sur le travail ne profitent qu’aux insiders ou à ceux qui se trouvent dans l’entreprise. En voulant modifier, dépoussiérer, réviser, ou simplifier, comme on voudra, les textes régissant le travail, on ne fait que valoriser une population au détriment d’une autre ou de celle qui en est exclue. Adam Smith disait qu’au banquet de la nature, il n’y a pas de place pour les pauvres et William Simon d’ajouter en 1981 que la pauvreté était bien entendu le fruit de la paresse. Chaque actif dans cette logique, stimulé par un État se disant « Protecteur », défend ses acquis sociaux de la meilleure façon qu’il peut et avec les moyens dont il dispose. Aussi, lorsqu’on avance le mot travail, tout est dit et il faut bien garder à l’esprit que le droit du travail renvoie donc aux seuls droits des actifs mais en rien aux outsiders. Une alternative serait alors que nous nous acheminions vers une autre société ou comme le disait Claudio Prado au Brésil : « L’emploi est une espèce en voie d’extinction ». Ainsi, nous pourrions passer directement du 19e Siècle au 21e Siècle en supprimant le mot travail. Mais nous n’en sommes pas encore là.
Corinne BERGER
Point de vue 7 : Juillet 2016
Les 23 et 24 juillet 2016, des automobilistes ont attendu plus de quinze heures à Douvres pour se rendre sur le Continent tant le nombre de véhicules était important. Quelques raisons ont été invoquées comme le système de sécurité renforcé, l’isolement progressif de la Grande-Bretagne, et à l’opposé, le grave manque d’effectif au port ou l’intérêt porté par les anglais de venir sur le continent. On invoque toutes les causes possibles, mais en aucun cas l’afflux de voiture. Pourtant, ce phénomène n’est pas nouveau. Il se joue régulièrement ailleurs, avec les mêmes scènes, avec évidemment les mêmes explications. Le 2 août 2014, 994 kilomètres de bouchons cumulés étaient comptabilisés en France, le 1er août 2015, 820 kilomètres, le samedi 13 août 2016, 854 kilomètres. Le phénomène automobile est déjà en soi extravagant, quand on sait qu’un moteur doit fournir de l’énergie à plus d’une tonne et demi de ferraille pour déplacer quelques personnes, voire une seule, dont le poids total va osciller entre 80 et 250 kilogrammes. Mais le comble de l’absurde est de se retrouver immobilisé, tout comme des boîtes de conserve alignées sur une route allant de Perpignan à Lille.
Certains disent que l’humain est dans le fond un nomade, et que ses déplacements seraient vitaux. Mais alors pourquoi ne se déplace-t-il pas à pieds ? D’autres mettent en avant des formes d’aliénation qui poussent les individus à ne plus être eux-mêmes mais de simples rouages de consommation. Ainsi, par effet de miroir, il faut absolument « bouger » ; à la mer pour les vacances d’été, et à la montagne pour celles d’hiver. D’ailleurs si vous ne le faites pas vous êtes assurément un imbécile. D’autres encore pensent que ces flux proviennent d’une recherche d’exotisme. Mais alors pourquoi s’agglutiner et se concentrer au même endroit et en même temps, alors qu’il y a des territoires totalement vides et oubliés ? D’autres admettent que ces mouvements permettent de se reposer, revisitant Sénèque qui vantait les mérites du temps de loisir le considérant comme la caractéristique de l’homme vraiment libre, ou St Thomas d’Aquin qui parlait, pour sa part, de la nécessité du « loisir réparateur ». Or, se retrouver dans un embouteillage pendant des heures est-il si reposant ? D’autres encore disent que ces transhumances ouvrent de nouveaux horizons et de nouvelles manières de voir le monde. Si dans l’absolu cela peut être vraisemblable, pour ma part, j’en doute. Certains enfin se targuent de pouvoir se détendre dans leurs résidences secondaires. Passer alors du temps coincé sur une route surchargée en vaut bien la peine.
Mais on pourrait aussi penser que les individus se déplacent comme cela, parce qu’ils ne se sentent pas bien chez eux, dans leur environnement quotidien ; ils travaillent toute l’année pour améliorer leur petit intérieur en allant chercher quelques babioles dans des zones commerciales tentaculaires. Puisqu’ils ne s’y sentent pas en osmose, ils prennent donc la fuite. Le problème est que tous prennent la tangente vers les mêmes territoires, sur les mêmes chemins, avec les mêmes moyens de locomotion. Si nous en arrivons à un spectacle aussi ahurissant et si cette idée de mal vivre relève en partie de son lieu d’habitation, c’est ce dernier élément qu’il faut réinventer.
Ne faut-il pas dès lors repenser nos modes de vie quotidiens ? Ne faut-il pas revoir nos modes de résidence ? Ne faut-il pas imaginer de nouvelles manières d’habiter ? Ne faut-il pas enfin revoir nos manières de travailler ? Dans ces conditions peut-être que nous pourrions éviter cette folie aveugle. Le problème est que nous n’en sommes vraiment pas encore là.
Jean-Luc ROQUES
Point de vue 8 : Décembre 2016
Où sommes-nous ? Dans le temps, dans l’espace, dans le monde vivant, dans le monde des déchets… Einstein, au début du siècle passé, développe la relativité générale et démontre malgré lui que l’univers est en expansion. Il aurait préféré garder un univers éternel, mais ses équations et les observations des astrophysiciens concluent à un univers qui évolue, il n’est pas éternel, mais a un début et une fin… Le début, connu sous le nom ironique de Big Bang, a eu lieu il y a 14 milliards d’années. Sa fin est plus incertaine, mais certainement plusieurs dizaines de milliards d’années. Plus localement, notre soleil est un soleil de 3e génération qui est apparu il y a environ 4 milliards d’années. Il durera encore environ 4 milliard d’années puis enflera en géante rouge. Les conditions favorables à la vie sur terre se maintiendront 500 millions d’années. Nous n’avons donc pas à craindre pour nos enfants et petits enfants, ils ne verront pas la fin du monde cosmologique. L’homme moderne sort des grottes de l’histoire il y a environ un million d’années et, peut espérer survivre quelques centaine de millions d’années. Nous sommes donc au début de notre existence.
Sommes-nous seuls ou bien la vie est-elle partout dans l’univers ? Dans l’espace notre soleil personnel brille parmi les 200 milliards de soleils de notre Galaxie et les 200 milliards de galaxies dans le cosmos visible. En terme de probabilité, on peut être certain de ne pas être unique. Pour donner une image moins numérique, promenez-vous sur une belle plage de plus de 10 kilomètres de long et ramassez un grain de sable. Et bien, il y a plus d’étoiles dans notre galaxie et plus de galaxies dans le cosmos que de grains de sable sur cette plage. Pensez-vous que votre grain de sable se sente seul et unique sur la plage ?
Sommes-nous grand ou petit ? Nous sommes un million de fois plus grands qu’une bactérie, mais petits par rapport aux éléphants et aux baleines, et comparés aux autres éléments de l’univers ? Les astrophysiciens annoncent un rayon de l’univers de 14 années lumière. L’univers est donc 1, suivit de 26 zéro. La physique quantique impose une limite inférieure pour la distance entre deux points, c’est la longueur de Planck. Nous sommes 1.6 suivit de 35 zéro plus grands que la longueur de Planck. On peut aussi dire que l’homme est une grosse pièce du puzzle de l’univers. On peut aussi interpréter ces limites du cosmos comme la preuve que la géométrie est une invention de l’homme, les mathématiciens ont inventé l’infini qui petit ou grand n’existe que dans l’imagination des hommes et des femmes mais pas dans le monde réel…
Comment l’homme se situe face à la pollution ? Si on écoute les écologistes, l’homme serait le premier animal à provoquer une catastrophe climatique… En fait, ce sont les cyanobactéries qui ont ouvert le jeu il y a 2.4 milliards d’années par photosynthèse. Elles ont libéré de l’oxygène, qui était un poison pour la plupart des autres formes de vie de l’époque. Puis la vie s’est adaptée, dès lors, elle profite de l’oxygène et c’est la prolifération des espèces au Cambrien, il y a 600 millions d’années. L’activité de l’homme va t-elle avoir un rôle équivalent à l’activité des cyanobactéries ? C’est vrai qu’en brulant les combustibles fossiles, il augmente le CO2 de l’atmosphère et, par là, provoque un réchauffement de la planète. De plus, les pollutions liées à ses déchets intoxiquent les animaux et rendent stérile les terres et les océans. C’est ainsi que les banquiers avec leur volonté de rentabiliser les capitaux nous mènent vers la 6e extinction de masse. Notez que nous faisons partie des espèces menacées, mais pas de panique les lichens, les champignons, les bactéries et les insectes survivront à cette extinction.
Peut-on être plus positif ? Oui, en cherchant non seulement à limiter les émissions de CO2 mais aussi à contrer les effets nuisibles du réchauffement. Une nouvelle espèce est-elle émergente ? Peut-être les objets connectés, ces objets comme votre futur congélateur, qui grâce à une puce incorporée dans son circuit électrique commandera automatiquement les ice cream et les petits poids quand ceux-ci seront en « solde ». Et l’homme et les animaux seront eux aussi connectés. Plus de risque d’enlèvement, plus de déplacements inutiles, vous pourrez voter tout en restant devant votre TV, une fois connecté…
Où sommes-nous parmi les intelligences ? Les intelligences artificielles, dont certains ordinateurs sont les premiers balbutiements avec les algorithmes, gèrent les marchés financiers plus rapidement que les spéculateurs. Ces organismes de silicium ont probablement des mémoires vastes et plus rapides que nous, ils gèrent nos messages, nous servent d’encyclopédies, assurent nos achats à partir de claviers.
Où sommes-nous dans le monde de la pensée ? Classiquement la pensée n’existe pas hors de la parole donc nous sommes seuls dans ce monde. Mais les études scientifiques montrent que la pensée est partiellement indépendante de la parole. Le comportement de certains oiseaux est le reflet d’une telle pensée. Confection d’outils à partir d’une brindille pour déloger des larves. Et leur chant qui peut être une réorganisation de sons entendus, un peu comme nos compositeurs… Avec un peu d’imagination nous ne serons pas seuls dans le monde de la pensée avec des acteurs biologiques et d’autres informatiques.
Yves de Ribaupierre
Point de vue 9 : Mars 2017
Je rencontre Safi, le 9 février dernier, au centre humanitaire ouvert depuis mi-novembre pour les migrants sur Paris afin de mettre fin aux campements dans les rues de la capitale. Il a 22 ans et vient d'Afghanistan qu'il a quitté il y a 18 mois après que son père, médecin, ait été tué par les talibans.
Comme lui, les migrants fuient avant tout pour survivre. La majorité des personnes qui entrent illégalement en Europe sont originaires de pays en guerre dont le Soudan, la Syrie, l'Erythrée, la Somalie et l'Afghanistan. Ils fuient des pays dévastés où l'on manque de tout. Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés, les hommes seuls ne représentent en 2016 que 53 % des migrants. Ce sont de plus en plus des familles qui migrent vers l'Union européenne.
Safi a attendu 6 jours et 7 nuits dehors avant de pouvoir être hébergé pour 10 jours sur place, d'y être nourri et de recevoir un sac avec quelques vêtements et du savon issu de dons. Nous échangeons en anglais mais il souhaite apprendre notre langue dont il connait quelques mots grâce aux militaires français en poste dans son village natal. Un rendez-vous à la préfecture lui a été donné pour fin mars (30 jours plus tard quand la loi fixe un délai de 3 jours) afin de déposer sa demande d'asile. Il se retrouve à nouveau à la rue dans l'intervalle sans aucun moyen de subsistance. Je suis sans nouvelles de lui depuis.
La procédure de demande d'asile prévoit qu'à compter du dépôt officiel, la personne bénéficie d'un hébergement et d'une allocation de 6€80 par jour pour se nourrir et subvenir à ses besoins, et ce le temps d'instruction de son dossier dont la durée moyenne actuelle est de 6 mois. En France, le taux de reconnaissance de ce statut se maintient aux alentours de 30 % des dossiers (ce qui est inférieur à la moyenne européenne)1, soit 36 233 protections accordées en 2016 2. « Entre 2012 et 2015, le nombre de personnes « déracinées » par les conflits et les persécutions dans le monde est passé de 45,2 millions à 65,3 millions. Ce chiffre record, le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, s’explique par la multiplication des conflits et l’installation dans la durée de ces derniers. Même s’il faut rappeler que 86 % des réfugiés demeurent dans des régions en voie de développement, l’Europe a été largement impactée par l’augmentation de déplacés. »3
L'augmentation du flux de migrants, en provenance de pays majoritairement musulmans, a fait porter le débat public sur les questions suivantes : comment partager les richesses sans mettre en péril notre système économique et social, comment accueillir des personnes de culture différente sans risquer de perdre notre propre identité, comment définir une position nationale dans un contexte de politique européenne et de conflits mondialisés, quels sont nos devoirs et responsabilités dans la crise actuelle et comment trouver des solutions compatibles avec notre tradition et notre histoire ?
Une fois les termes du débat posés, les uns et les autres développent des arguments contraires selon leurs sensibilités politiques, religieuses, philosophiques ou intellectuelles. Que peut nous apprendre la longue histoire de notre évolution pour éclairer la situation présente ? Les sociétés se complexifiant « les hommes n'ont cessé de créer l'ordre dans leur société en classant les populations en catégories imaginaires du style : supérieurs, roturiers et esclaves ; Blancs et Noirs (…) riches et pauvres… [Or], il faut une tribu pour élever un homme. Aussi l'évolution favorisa-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux »4. Offrir l'hospitalité c'est donner quelque chose de soi qui se situe au-delà du service.
Elisabeth ORTEGA
1 Article de Boris MANENTI publié sur lemonde.fr daté du 26 octobre 2016
2 Mémorandum de France Terre D'Asile pour les élections présidentielles 2017
3 Idem
4 Sapiens : une brève histoire de l'humanité, de l'historien Yuval Noah HARARI qui établit une analyse des grandes tendances de notre espèce. - Editions Albin Michel, 2015.
Point de vue 10 : Juin 2017
Nous sommes actuellement submergés d’élections qui offrent en principe aux électeurs, par le vote, une liberté de choix. Elections sociales, avec leurs représentants syndicaux, leurs délégués de classe, leur président d’association locale ou leur syndic de copropriété. Elections politiques, pour les députés, les sénateurs ou le Président de la République. Elections administratives, pour élire des représentants départementaux ou communaux. Toute activité semble sujette à cette procédure, présentée comme une avancée démocratique incontestable, dont le but, en principe, serait d’éviter que la raison du plus fort ne soit toujours la meilleure. Or, si la démocratie ne se limite pas au vote, le système électif n’est en rien ni un gage de représentativité, ni de démocratie.
Nombreuses sont les situations où les élections sont truquées, et localement, les méthodes d’achat de voix, de corruptions, et de pressions sont légions. D’ailleurs, comme l’écrivait Théodore Zeldin : « Ceux qui étaient censés obéir aux lois sont passés maîtres, grâce à une longue pratique, dans l’art de s’y dérober ». On peut alors se demander où se situe la justice ? De plus, le vote en donnant à l’ « autre » sa voix, au sens propre et figuré, rend par la suite le votant muet, éloigné de toute prise de décision possible, mais aussi dénigré et méprisé. On peut se demander où se trouve le pouvoir de faire et de dire ? Le cas de l’intercommunalité est symptomatique d’autres dérives. Il existe déjà un défaut de démocratie car, toutes choses égales par ailleurs, nous sommes assez proches d’un suffrage censitaire sans, bien entendu, que les membres payent le Cens mais en revanche en retire de nombreux bénéfices. Ainsi, il subsiste une interrogation concernant l’efficacité de gestion. Lorsqu’il n’y avait que des communes, il fallait financer, notamment pour les plus petites, les indemnités du maire, et un ou deux adjoints, sauf absurdité un troisième. Aujourd’hui, cette base communale reste identique mais nous avons en plus un président pour la Communauté de communes et une dizaine de vice-présidents avec à la clé une première réunion très importante qui portera sur le taux d’indemnité de chacun. On peut effectivement se demander où se trouve la rationalité économique ? Enfin, il est admis que celui qui, lors d’une élection, obtient 50 % des suffrages, plus une voix, sera le gagnant et les partisans seront très heureux de ce sacrement de leur « Elu ». En revanche, celui qui a 50 %, moins une voix, sera le perdant et les partisans seront très déçus de ne pas avoir sacré leur « Elu ». On peut donc légitimement se demander où se trouve l’équité dans de telles conditions ?
Il n’est pas étonnant que, de manière récurrente, le système électif soit remis en question et cela à quelques niveaux que ce soit. De nombreux mouvements et courants ont depuis longtemps dénoncé ce mode de représentation. Le mouvement de mai 1968 avait mis en avant, de manière plus radicale, le slogan : « Election piège à Con ». Aujourd’hui, le taux d’abstention est certainement un bon indicateur de cette défiance actuelle. Certaines approches avancent qu’en modifiant les fondements du système et en privilégiant par exemple le tirage au sort, les dysfonctionnements seraient évités. Mais tout cela peut-il résoudre le problème de fond ?
Si l’on admet que l’élection n’est en rien équitable, qu’elle n’est pas juste, et ne débouche sur aucune rationalité économique, en revanche, elle est bien à relier au pouvoir que certains souhaitent exercer sur d’autres. Le problème est dès lors ce pouvoir que quelques-uns recherchent puis s’octroient. Chez les Grecs de l’Antiquité, l’ostracisme était le fait de mettre à distance un individu dont on considérait qu’il était potentiellement dangereux pour les affaires de la cité, mais il désignait surtout la procédure de bannissement d’un homme politique dont on craignait l’ambition ou la puissance. Le souci c’est que nous n’en sommes pas encore là, voire même, nous nous en éloignons très certainement. Et je ne peux m’empêcher, pour terminer, de citer la définition de la démocratie que propose avec ironie Thibault Lecourt : « Dynamique au cours de laquelle une personne disposant d’un pouvoir délégué par la population se soustrait à cet impératif pour servir des intérêts autres que ceux pour lesquels elle a été désignée temporairement. »
Jean-Luc Roques
Point de vue 11 : Septembre 2017
On sait qu’actuellement environ 360 communes, en France, sinon plus, refusent l’installation sur leur territoire du nouveau compteur d’électricité de type « Linky ». Elles avancent que celui-ci porterait atteinte à nos libertés, qu’il serait dangereux pour notre santé. Aussi lorsque l’entreprise de distribution d’électricité, responsable de ce service public délégué par les collectivités locales, frappe aux portes des abonnés pour installer ce fameux compteur, certains édiles estiment qu’il est de leur devoir de les en empêcher. N’y aurait-il pas là une forme de résistance aux monopoles des grands groupes ? Ajoutons aussi le caractère énergivore de ce compteur, contrairement à l’ancien modèle. Il ne s’agit pas ici de dire si nous sommes pour ou contre ce compteur, mais de se demander comment en « bon père de famille » ces maires seraient capables de nous mettre à l’abri de tels risques.
Au quotidien, nombreuses sont les situations où des individus sont victimes d’atteintes à leurs droits et libertés. Prenons l’exemple des caméras de surveillance dont certains magasins sont équipés ou celui des radars qui contrôlent la vitesse des véhicules. Les feux dans les agglomérations indiquent qu’il faut s’arrêter au rouge, pour laisser passer d’autres véhicules, et circuler au vert. Les routes sont facteurs d’accidents corporels, ainsi que les voitures qui sont la cause de pollutions sonores et atmosphériques. Les guichets automatiques des banques scrutent les faits et gestes des consommateurs lorsqu’ils y retirent de l’argent. Les téléphones portables permettent non seulement de connaître l’emplacement de toute personne mais peuvent nuire à la santé des individus. Que dire de l’accès internet, il sait tout comme l’œil de « Big Brother », il peut être une forme d’addiction. Les médias, comme la télévision ou la radio, sont sources d’aliénation. Il faut donc bien admettre que tout le monde se fond dans la masse. Tout comme ces millions de téléspectateurs qui à la mi-temps des matches diffusés se rendent aux toilettes et tirent d’une seule main la chasse. On imagine aisément les conséquences sur le réseau d’eau et le diamètre adéquat qu’il faut prévoir en de telles circonstances. Aussi, les populations ne sont pas à l’abri de tels risques, le compteur Linky n’en est qu’un de plus.
Cependant, bon nombre de ces collectivités, paradoxalement, réclament à cor et à cri le haut, puis le très haut débit, le train à grande vitesse, puis à très grande vitesse. La plupart d’entre elles ne sont pas prêtes à renoncer aux zones d’aménagement urbain et leurs lotissements dédiés ; aux routes, et si cela est possible aux brettelles d’accès à l’autoroute la plus proche. Laquelle d’entre elles ne demande pas une rocade ou une voie de contournement du bourg qui détruira de nouvelles terres agricoles. Laquelle, en définitive, a fait le choix d’une entreprise locale de distribution d’électricité ? Les usagers quant à eux admettent de bonne grâce profiter de ces nouvelles technologies. Ils ne se privent pas de l’accès aux services publics de distribution d’eau potable, de ramassage des ordures ménagères, de diffusion de la radio ou de la télévision. Il leurs semble alors raisonnable d’en subir quelques désagréments.
Il apparaît alors que ces collectivités, plutôt avides d’innovations en tout genres, ont plutôt opté pour une espèce de « propagande à la carte » en contestant cette nouvelle génération de compteur. Et que ces élus « pseudo militants » accueillent par ailleurs sur leurs territoires des antennes relais de télévision et ne se soucient guère des incidences auprès des habitants. Ces derniers seraient-ils prêts à vivre sur un îlot et faire le choix de la sobriété ? On peut sérieusement en douter !
Corinne Berger
Point de vue 12 : Décembre 2017
De multiples rapports et études émanant d’officines, d’organismes, d’institutions, qu’ils soient publics ou privés, sont publiés quotidiennement. L’INSEE, par exemple, montrait récemment qu’il y avait un rebond de la croissance en 2017 soit plus 2,4 % par rapport à 2016. L’économie française aurait ainsi enregistré une croissance de 0,5 % du PIB au second semestre et celle-ci atteindra 1,6 % en 2017. Pour sa part, en 2015, en volume, la dépense de consommation finale des ménages augmentait plus fortement qu’en 2014. Elle contribuait pour 0,8 point à la croissance du PIB.
Toutefois, si certains rapports sont médiatisés, d’autres en revanche restent dans l’ombre, quant ils ne sont pas dénigrés ou oubliés. C’est en grande partie le cas du rapport de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) de mars 2017, qui est passé sous silence. Si globalement 785 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, le rapport montrait que, 108 millions de personnes vivaient en situation d’insécurité alimentaire ou pire. Le problème était considérable puisqu’il y avait une augmentation importante par rapport à 2015 où 80 millions d’individus se trouvaient dans cette situation et à la fin de l’année 2017, cette insécurité devrait notoirement s’intensifier.
Déjà, considérons qu’il existe un « léger » hiatus entre ces éléments et les modes de vie que nous connaissons en France. En effet, chaque année dans l’hexagone, les français, qui ne meurent pas ou peu de faim, gaspillent dix millions de tonnes de produits alimentaires, dont 1,2 concerne de la nourriture encore consommable. Cela représente globalement vingt kilogrammes par habitants et par an. Au-delà de cette situation absurde, le coût global est de plus de dix milliards d’euros, et représente 15,3 millions de tonnes de CO2. Les détracteurs pourront dire que cette comparaison entre insécurité alimentaire dans certains territoires et surconsommation dans d’autres est assez fallacieuse, puisqu’il n’existe pas véritablement de vases communiquant entre les deux. Le fait de moins manger en France ne donnera pas plus à manger dans d’autres pays. Certes, on pourrait accepter cette remarque, sauf que le rapport de la FAO met en avant trois causes qui ne sont pas très surprenantes, mais qui devraient poser quelques problèmes à ces mêmes détracteurs. Les trois causes présentées par la FAO sont les conflits, la flambée des produits alimentaires, les anomalies climatiques.
On peut dès lors s’interroger sur ces différentes causes. Tout d’abord, si les conflits, de plus en plus intra-étatiques, sont difficiles à régler, ceux-ci ne se font plus avec des arcs et des flèches. D’ailleurs qui vend des armes à ces pays ? Les rapports d’Amnesty International sont sans ambiguïtés. La France fait partie des cinq plus grands marchands d’armes de la planète. En 2017, elle est même passée au 3e rang et pourrait devenir bientôt le second derrière les Etats-Unis. Ensuite, s’il existe depuis toujours des accaparements locaux de denrées alimentaires au profit de certains, qui aujourd’hui y gagne, voire qui provoque cette progression des prix ? Depuis, la dérégulation financière des années 1980, les matières premières sont accessibles aux banques et aux fonds d’investissement. La spéculation se réalise sur l’évolution des prix des matières agroalimentaires telles que le maïs ou le blé. Et ce sont ces banques d’investissement qui font grimper les prix des aliments, comme en France le Crédit Agricole ou AXA. Enfin, si bon an mal an tous les endroits de la planète polluent leur environnement, quelles sont les régions du monde qui favorisent le plus les anomalies du climat ? En millions de tonnes équivalents CO2, on retrouve la Chine, les USA, puis l’Union Européenne. Certes, pour se déculpabiliser on peut montrer que, si l’on pondère par habitants, se sont certaines monarchies du Golfe qui émettent le plus d’EGES.
Comme le suggérait déjà, il a quelques années, Susan George, L’effet boomerang risque d’être important, pour l’instant celui-ci n’est pas encore totalement revenu et reste accroché aux arbres des plus pauvres.
Jean-Luc Roques
Point de vue 13 : Mars 2018
Le groupe Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Orange est présent dans 21 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et y génère 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est aussi l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. Il est coté en bourse en France et aux États-Unis. Enfin, Orange est l'opérateur désigné pour le service universel qui prévoit « pour toute personne le demandant un raccordement fixe au réseau téléphonique, la fourniture d'un service téléphonique de qualité et l’accès à internet avec débit suffisant. »
Ceci étant dit, il paraît pourtant indéniable que la société France Télécom/Orange devient une entreprise pour qui la clientèle n'est plus la préoccupation principale et dont le but est de rémunérer ses actionnaires. Elle semble bien abandonner progressivement son statut de service public pour évoluer, hélas de plus en plus vite, vers des activités centrées sur une économie strictement libérale. Elle est, dans ce sens, davantage axée sur la connectivité des centres urbains au détriment des zones rurales qui demeurent encore trop souvent le parent pauvre de l'intégration territoriale avec une indéniable négligence dans l'entretien des supports (poteaux téléphoniques dégradés, réseaux souterrains à l’abandon). Cela ne peut amener qu’à nous interroger sur les finalités d'Orange : un service téléphonique basique mais efficace pour tous les usagers, surtout les plus âgés, ou un Internet très performant réservé à une élite branchée ?
A cela, il faut encore ajouter la difficulté de joindre un personnel autre que par une plate forme téléphonique anonyme et distante en cas de problème technique. Cet exemple particulier ne tend-il pas à montrer que notre société mercantile privilégie systématiquement la rentabilité au détriment du consommateur lambda commercialement peu attractif mais qui présente cependant le double intérêt de faire partie d'une clientèle captive peu apte, du fait de son âge ou de son isolement, à faire jouer la concurrence et qui, de surcroît, par lassitude ou renoncement fataliste répugne à faire valoir ses revendications. D’autres exemples, non exhaustifs, illustrent le peu de cas que font certaines sociétés vis-à-vis de leur clientèle. Il faut ici impérativement dénoncer la redoutable pratique des « centres d'appel » largement décentralisés dans des pays de main d'œuvre sous-payée qui déshumanisent la relation de service et/ou découragent le client peu aguerri par des délais d'attente interminables ou des renvois kafkaïens d'un service à l'autre. Une des plus caricaturales en ce domaine est sans conteste la société Canal+ qui accorde sans difficulté ses abonnements par téléphone mais rend paradoxalement extrêmement complexe leur résiliation par ce biais téléphonique, ce qui ne semble pas loin de friser l'illégalité.
Plus largement, ces quelques situations emblématiques posent un problème plus général, celui de savoir si les pouvoirs publics continuent de privilégier les activités et les régions les plus attractives parce que bien intégrées au système urbanisé et mondialisé et ce, au détriment des régions périphériques qui le sont peu, mal ou pas du tout (persistance de trop nombreuses zones blanches). Ce qui implique de ne raisonner que dans une perspective de rentabilité immédiate, laquelle est bien évidemment le critère unique et implacable de toute entreprise capitaliste, mais aussi hélas, semble bien devenir celui des services publics.
Comment alors, dans cette logique perverse, pouvoir espérer revitaliser ou dynamiser de façon durable ces tissus ruraux sans y maintenir ou y installer les services les plus essentiels à la santé, la culture et l’économie ?
Pascale Berger
Point de vue 14 : Juin 2018
Une ville a construit sa renommée sur la tomate. Une fixation qui n’a aucune raison d’être, car partout en France, elle est produite. Initialement de couleur jaune, puis rouge, elle est d’un potentiel de plus de 10.000 variétés polychromes et multiformes. Ce fruit associé au soleil, cette « solanée » a investi des lieux moins propices à sa croissance. Cette pomme d’amour, appellation occitane, pousse hors-sol. Deuxième plante commercialisée sur cette planète, sa production a voulu s’extraire du cyclique et, s’inspirant de l’industrie, adopta le linéaire. L’Empire de l’or rouge(1), qui vient de paraître, révèle ce mode de production mondialisé. Les incidences affectent tout (systèmes productifs, fraude, santé, conditions de travail, crises migratoires, corruption). Summum d’opacité d’un aliment banal : la sauce tomate.
Le système hors-sol est un symbole de l’ère industrielle. Apparu voici quatre décennies, plus de 80 % des tomates fraîches se retrouvent sur le marché selon ce procédé cultural. L’enseignement agricole fit sa promotion en affichant son caractère novateur, modèle d’une agriculture de qualité. Un ouvrage de vulgarisation expliquait dès sa première leçon : Le sol est un support. Il ne manqua qu’un coup de pouce pour lancer l’innovation devenant la norme. Subventionnées jusqu’à 70 % des coûts d’installation, les campagnes virent se couvrir de serres. Elles sont badigeonnées l’été d’une substance chaulée à fort potentiel accrocheur afin d’éviter les coups de chaleur occasionnant des effets brûlants pour les apex des végétaux. En automne, une cohorte de balayeurs sont remplacés par des robots. L’hiver, de grandes cheminées crachent leurs fumées blanchâtres masquant le CO2. La tomate est exigeante en chaleur et son zéro de croissance est à 12°C. Des études ont pourtant montré que le coût énergétique de production par kilogramme était déficitaire.
Les systèmes de récupération des lixiviats liés aux substances nutritives ainsi que l’eau de pluie sont inexistants. L’évacuation s’effectue dans des fossés imperméabilisés par du plastique qui sous l’effet des ultraviolets et infrarouges se détériorent et laissent s’infiltrer l’eau chargée d’éléments nutritifs non absorbés. La majeure partie part dans un puisard. La comparaison sol/hors sol de la consommation d’eau par kilos produits en référence au modèle dominant conventionnel ne prend pas en compte ce problème. En ce qui concerne les valeurs organoleptiques des produits, les études montrent que les consommateurs sont floués. Les taux de vitamines ou de lycopène sont en deçà des productions en pleine terre. La matière sèche est basse même si l’adaptation d’anciennes variétés est d’actualité. Quant au goût ?
Enfin, ces usines exploitent la main-d’oeuvre. L’absence de syndicats, excluant les modalités d’application du droit, favorise l’illégalité et certaines structures s’y complaisent. Deux ans de lutte, pour obtenir des chaussures de sécurité, des protections contre les produits de traitements, des casques lors de travaux de force, une prise en compte d’un temps effectif de pause. Deux ans de revendications pour éviter la récupération immédiate de jours fériés sans compensation d’heures supplémentaires, les passe-droits lors de l’absence de prise de congés annuels afin d’obtenir un CDI, le non suivi d’accident ou de malaise par faible anticipation caniculaire d’horaires différés, les fins de contrats non négociées entraînant une prise en charge différée des indemnités de licenciement. De 60 à 70 % des salariés sont des femmes, ce qui perpétue la tradition, car tel était la tendance chez Heinz, la première firme qui a mis en place le travail à la chaîne.
Rémi Roussille
(1) Jean-Baptiste Malet, L’Empire de l’or rouge, Paris, Fayard, 2017.
Point de vue 15 : Septembre 2018
Les biens « communs » ou « communaux » peuvent être constitués de bois, de pâturages et de terres à vocation agricoles ou pastorales. Et l’affouage est la possibilité donnée par le code forestier à un conseil municipal, afin que celui-ci réserve une partie des bois de la forêt communale pour l’usage domestique des habitants. Mais que se passe-t-il lorsque la demande de ce bois de chauffage devient trop importante et que la forêt n’a pas le temps de se régénérer ? Ou dit autrement, que se passe-t-il lorsque la demande augmente et que dans le même temps la quantité de bois diminue ? Cet affouage peut alors devenir la hantise des élus et susciter de multiples convoitises. Les bois dits « sectionnaux » ne sont-ils pas dès lors un enjeu pour les collectivités locales, les élus et les habitants ?
L’affouage est partagé à raison d’une coupe par foyer. Généralement, les personnes admises répondent aux critères de posséder, ou d’occuper, un logement fixe, réel, dans la commune et de se chauffer aux bois. Ainsi, les lots de bois sur pied sont répartis à superficie égale entre les inscrits, par tirage au sort. La municipalité fixe chaque année le prix de la taxe d’affouage. L’exploitation se fait soit directement par le bénéficiaire, soit par une entreprise agréée de son choix ou par un exploitant forestier voté par le conseil municipal. La contrainte principale est que l’affouagiste ne peut vendre le bois qui lui a été délivré, et doit l’utiliser pour sa consommation personnelle. L’application de ce règlement, sous la responsabilité des membres d’une commission appropriée, prévoit, outre les conditions d’attribution de ces coupes de bois et la surface de bois délivrée aux affouagistes, les dates de début et de fin d’inscription, les délais d’exploitation des lots et d’enlèvement des bois.
Les problèmes surviennent lorsque la mairie, propriétaire des biens, sans en avoir ni l’usage ni la jouissance, se trouve confrontée à d’anciennes coutumes. Ces « sectionnaux », en effet, n’appartiennent pas ici au domaine public de la commune, mais sont plutôt des biens faisant partie du domaine privé de celle-ci. Le « sectionnal » constitue donc la « propriété collective des habitants », et un bien qui n’appartient à personne en particulier. L’affouage, ou le bois de chauffage, n’est pas pour autant un droit pour les habitants car seul le conseil municipal peut décider d’organiser ou non une coupe affouagère. Des conflits peuvent alors naître car on se retrouve avec d’un côté, la collectivité publique qui revendique ce foncier et de l’autre, des habitants qui ne souhaitent pas le partager outre mesure. Les premiers avancent que ces bois doivent profiter à l’ensemble des habitants de la commune, tandis que les seconds prétendent avoir sur ces biens, un droit réservé, parce que cet affouage, disent-ils, est ancestral. Et d’ajouter que dans ce cas, il ne peut profiter qu’aux anciens ou à ceux qui y sont inscrits depuis longtemps.
On voit par là, que lorsque la ressource se fait plus rare, des tensions peuvent ressurgir. Anciennement, le seigneur local accordait une concession gratuite à la communauté des habitants, mais il le faisait essentiellement pour les pauvres. Lorsque les communaux furent mis en place cela permettait aux plus déshérités de survivre. Or, dans notre cas, ce n’est pas toujours le moins riche qui profite de l’affouage, mais plutôt, pour la plupart, des habitants qui par ailleurs possèdent des forêts. Le principe ici étant pour ces derniers, de conserver leurs propres ressources en bois, tout en profitant des communs qui à l’origine ne leur étaient pas destinés.
Art. L 243-2 du nouveau code forestier (anc code art. L 145-2).
Corinne BERGER
Point de vue 16 : Décembre 2018
L’univers a environ quatorze milliards d’années. Des étoiles primitives ont explosé, libérant une poussière de matière (carbone, oxygène de fer, silicium). Il est en expansion et les galaxies s’éloignent (les atomes restent de la même taille). La gravitation remodèle la matière libérée. Il y a quatre milliards et demi d’années, Soleil et Terre se sont formés à partir de cette poussière et de l’hydrogène primitif. La vie a débuté il y a trois milliards d’années par des êtres unicellulaires. Puis celle-ci a évolué, aboutissant aux arbres et aux animaux.
Cette évolution ne s’est pas faite sans heurts, mais avec une prolifération d’extinctions. La géologie montre qu’il y a eu cinq extinctions, dont la dernière date de soixante millions d’années (disparition des dinosaures). Les biologistes admettent que, depuis cent ans, la moitié des espèces connues ont disparu. Si les cinq premières disparitions avaient des causes naturelles, la sixième coïnciderait avec le développement de l’industrie. L’observation de la température montre un réchauffement de la planète et préoccupe. Cette augmentation va produire une montée des eaux par dilatation des océans et fonte des glaciers. J’ai une question brutale : La disparition de l’homme fera-t-elle partie de la sixième extinction ? Je ne me fais pas de souci pour les mouches, les scorpions ou les araignées, mais je suis plus inquiet pour les oiseaux, les mammifères ou les vers de terre qui sont des jardiniers discrets et rendent la terre fertile et poreuse. Nos ingénieurs, créant des voitures électriques, des lampes qui consomment moins, des micro-ordinateurs, seront-ils capables de résoudre ces problèmes ? L’humanité survivra-t-elle ? C’est possible mais pas certain. Le recyclage serait une solution contre l’épuisement des ressources et la pollution. Malheureusement, nos déchets ne sont recyclables qu’à 50 %, ce qui ne fait que reculer la disparition des ressources de quelques centaines d’années.
On pense que la croissance résoudra les problèmes, mais elle ne fait que diviser les populations en très riches (en petit nombre) et très pauvres (en grand nombre). Erreur de calcul que de penser qu’une croissance infinie est possible dans un monde fini. Rentabiliser l’investissement financier provoque la destruction. Une propriété du vivant est l’augmentation de la diversité avec le temps. Elle est menacée par l’activité bancaire. Pour un banquier, il est plus rentable d’investir dans une ferme de mille vaches que dans cent fermes de dix vaches. Il réduit la diversité des fermiers de cent fois. Les traditions sont utiles dans les boutiques de souvenirs pour touristes, mais elles ne résoudront pas les problèmes de diversité du futur. Construire un enseignement pour le futur est un challenge pour la survie de l’humain. La diversité des cerveaux ne nécessite-t-elle pas une diversité de l’enseignement ?
Le physicien Enrico Fermi posait la question : « Mais où sont les extraterrestres ? » Vu le nombre de planètes dans l’univers, il est probable que des millions de civilisations existent encore. Alors, pourquoi ne les voit-on pas ? Soit elles sont super écologiques et ne veulent pas réduire la diversité de l’univers. Soit elles ont épuisé leurs ressources avant d’avoir pu conquérir l’espace. Le paradoxe de Fermi peut orienter notre réflexion. La science peut engendrer des théories fausses, mais aussi les moyens de les corriger. Les anciens ont parcouru un long chemin utile pour comprendre le monde, mais il reste de multiples mystères. Ce sont ces mystères qui doivent éveiller notre curiosité pour permettre de développer la diversité de nos cerveaux. Face aux robots et algorithmes qui nous envahissent, toutes les acquisitions de notre cerveau doivent être réveillées. Le câblage de celui-ci est antérieur à l’apparition de l’homme et, sans cette diversité, nous disparaîtrons en moins de mille ans.
Yves de Ribaupierre
Point de vue 17 : Mars 2019
Dans les années 1970, un mouvement avait fait naître des radios émettant clandestinement, elles revendiquaient la liberté d’expression et la fin des monopoles d’État, effective en 1981. Par la suite, un principe fondamental fut celui du « pluralisme de l’expression de courants de pensée et d’opinion1 ». Adressé plus particulièrement aux professionnels de l’information, il impliquait, entre autres choses, la diversité des tendances et des objectifs. Pourtant, aujourd’hui, les médias sont souvent perçus comme de simples outils de propagande lorsqu’ils accordent aux questions politiques une place importante. Il est question ici non pas de s’engouffrer dans une quelconque critique virulente contre ces moyens de communication ou de faire des procès aux journalistes et présentateurs, qui d’ailleurs sont assez récurrents actuellement, mais de se demander ce qu’il en est aujourd’hui de cette pluralité et de cette liberté.
Prenons quelques exemples de formulations quotidiennes diffusées dans différentes émissions. Pour commencer, « L’attaque au couteau dans laquelle trois personnes ont été blessées », puis « La Légion d’honneur distingue également de nombreux policiers et pompiers », suivi par « Le ministère du Travail a annoncé de nouvelles sanctions pour les chômeurs », ou encore « La Bourse de Paris évolue en forte baisse, rattrapée par les craintes de ralentissement économique mondial », ou « Avec la multiplication des fusions, la France compte moins de communes ». Il est possible d’ajouter à tout cela « Plusieurs migrants sont morts en tentant de gagner les côtes dans une embarcation précaire », « Plusieurs personnes suspectées du vol et de l’incendie partiel de deux véhicules de type 4 x 4 ont été interpellées », « Des évolutions sont attendues l’année prochaine à la fois pour les retraités et les actifs qui préparent leur retraite. Une décote de 10 % sera appliquée pendant trois ans à ceux qui partent à l’âge du taux plein et avec tous leurs trimestres », et enfin « L’aviation civile a compté plus de cinq cents victimes dans le monde en 2018, tout en restant l’un des moyens de transport les plus sûrs ». Et l’on pourrait multiplier les entrées. Toutes ces informations passent du coq à l’âne, pêle-mêle, sans aucune transition. Il est remarquable de relever aussi une tendance à l’imitation dans le choix des informations sur la plupart des réseaux de diffusion. N’existe-t-il pas dès lors une confusion entre pluralité et quantité ?
De plus, actuellement, combien de fois les mots tels que « pouvoir d’achat », « croissance », « démocratie », « élection », « solidarité », « équité » ou « crise », pour ne donner que ces exemples, sont-ils prononcés à travers les médias ? Mots-valises, mots passe-partout, mots-idoles ! Ils semblent évoquer à eux seuls des idées qui paraissent déjà induites, comme celles du bienfait de la consommation des ménages ou de la participation des citoyens aux élections, mais aussi de la valorisation du travail dans l’incitation des actifs à décaler leur départ à la retraite, ou du libre choix des individus. Nous avons une rhétorique qui, encore là, est identique à celle de nombre de médias. On peut dès lors s’interroger sur cette liberté qui passe par la répétition de termes plutôt que par la diversité.
En conséquence, nous avons affaire à un ensemble d’informations similaires, initiées au niveau national et reprises de la même façon par les radios locales. Où se situent la pluralité et la liberté si tout est uniforme ? Pour recouvrer l’esprit des radios libres, faut-il alors laisser les réseaux sociaux s’engouffrer dans la brèche, avec le risque d’une profusion de données invérifiables, de fausses nouvelles, de théories farfelues, voire dangereuses ?
Corinne BERGER
1. Art. 1er L du 30 sept. 1986 et recommandation de la CSA.
Point de vue 18 : Juin 2019
On peut chercher à comprendre le monde en suivant divers chemins. Un de ces chemins est celui des analogies. Certes, il n’a pas la rigueur des déductions logicomathématiques ni la poésie des écritures romantiques, mais il est facile à parcourir et peut être source d’inspiration. La rêverie qui suit utilisera donc l’analogie. Je prendrai comme base l’image du virus et l’appliquerai tout d’abord à deux domaines, la biologie et l’informatique. Pour terminer, je me demanderai s’il n’y aurait pas un virus particulier qui infecterait les sociétés contemporaines et produirait des effets délétères sur notre environnement.
Partons des premiers virus découverts. Ce sont de petites structures d’ADN enfermées dans des cages de protéines. Ces structures sont trop simples et ne sont pas capables de se reproduire. Elles ne sont pas considérées comme vivantes. L’histoire d’un virus bactériophage ressemble à un module lunaire en miniature avec ses six pattes. Après avoir trouvé une bactérie à son goût, il se fixe à sa surface, puis lui injecte son filament d’ADN en pliant les genoux. Dès lors, la bactérie se met à multiplier ce fragment d’ADN ainsi que la cage protéique. Quand la cellule est remplie de ces réplications de virus, la bactérie explose. Ainsi, une structure non vivante réquisitionne des cellules d’animaux ou de plantes pour assurer sa reproduction. Pour pallier le problème, les biologistes ont inventé des remèdes qui permettent aux individus de lutter contre les infections virales. Ce premier exemple indique qu’il est possible de se débarrasser de certaines maladies en utilisant des vaccins.
Venons-en maintenant au cas de l’informatique. Les informaticiens ont rapidement découvert que des amateurs de sabotage de programmes utilisaient des petites séquences qu’ils ajoutaient aux fichiers transférés, que l’ordinateur recopiait alors de multiples fois. Ces séquences sont d’ailleurs analogues aux virus précédents. On a donné le non de « virus informatique » à ces programmes. Si les informaticiens n’ont pas pu inventer des vaccins, ils ont élaboré des détecteurs de virus qui bloquent le transfert du fichier contaminé. Ce deuxième exemple montre ici que les hackers sont bloqués dans leurs démarches grâce à des systèmes performants.
S’agissant du dernier exemple, et par analogie, l’argent ne serait-il pas une maladie grave de notre société ? Disons qu’il existe sous différentes formes, comme les billets, les actions, les obligations, les suites numériques dans les mémoires des banques. Toutefois, il reste amorphe et n’est pas vivant. Il devra pour circuler être injecté dans un établissement bancaire, afin que celui-ci puisse l’utiliser à son tour et qu’il finisse par se multiplier. Ainsi, l’argent ne ressemblerait-il pas à un virus ? En effet, il fait travailler les autres pour se reproduire. Le problème est que nos systèmes capitalistes considèrent l’argent comme un bien et qu’il facilite les échanges. Or ils ne voient pas que cette monnaie infecte la société, déstructure les valeurs d’égalité et de fraternité entre ses membres, détruit le tissu vivant que sont les forêts et les océans, qu’elle stérilise la terre, empoisonne son atmosphère et conduit inexorablement au réchauffement climatique et à la disparition de la diversité de la vie. Le souci est que personne n’a encore été capable d’inventer quelque chose contre le caractère viral de l’argent.
En fin de compte, le « capital mondial » gonfle exponentiellement sans jamais cesser de se reproduire. Ne pourrait-on pas alors terminer par une dernière analogie qui est celle de la mauvaise graisse ? On sait que cette dernière déforme, rend malade et invalide. Pour nos sociétés, ne pourrait-on pas élaborer, comme nous le faisons pour les obèses, un régime amaigrissant ?
Yves de Ribaupierre
Point de vue 19 : Août 2019
Entre mars 2018 et avril 2019, 191 cyclistes ont été tués sur les routes de France. Choisir de devenir une personne qui fait du vélo1, plutôt que de s’essayer à être cycliste, comporte une assurance de relative pacification avec la gent automobile. L’hommauto2 ne tolère que peu ou pas la lenteur. Obsédé par la pole position, sa propension au partage de la chaussée faiblit à chaque changement de vitesse et est inversement proportionnelle aux coups d’accélérateur. Souvent, les aménagements routiers ne l’incitent pas à freiner ses égocentriques comportements, il ne peut attendre obstinément, impatient derrière un deux-roues non motorisé à l’intersection annoncée. Les ralentisseurs devraient le modérer, donc lui éviter de doubler systématiquement un moins véloce, inciter sa raison à économiser son précieux carburant car, du freinage à la reprise, la civilité chute et l’enfumage prévaut tant que ronfle sous le capot la bête.
Lors d’un conflit entre homme à vélo et hommauto, l’aide d’un commerçant au plus près de sa boutique est acquise à ce dernier. L’aidant désertera son officine à la fois pour sermonner l’inconscient à vélo de mettre en danger son si petit corps sans armure, susceptible d’être percuté par un rétroviseur, fracassant son coude, ses côtes, couronnant son genou sur des cailloux bitumés, et pour qualifier le suspect d’irresponsable, enclin à la désobéissance, de presque rebelle, et surtout d’irrespectueux du code de la route. L’inconscient rouleur sur selle est suspecté parfois d’attentat à la pudeur par son accoutrement pittoresque sans carrosserie. Adepte de la rue sans monoxyde d’azote et autres molécules odoriférantes, très mauvais animateur, casseur d’ambiance sonore indispensable à l’évitement du silence de mort... parano, le cycliste peut le devenir.
Le vieil automobiliste peut rouler à l’anglaise, ne laissant que peu de chance au vélo, quand il aborde une chaussée rétrécie pour le franchissement d’un cours d’eau. Un pont ! Le jeune ne se la joue pas rogatons. Il a eu du goût pour embellir sa cylindrée – je passe les détails que je n’ai pas eu l’occasion d’apercevoir – d’un capot à damier. Partez, fuyez la ville en de belles espérances de courses effrénées avec le temps, celui-ci météorologique. Inconcevable de salir cette poubelle, alors évitons les flaques d’eau et leurs éclaboussures fangeuses, et cueillons ce deux-roues que je ne saurais voir.
La personne qui fait du vélo doit garder son humour, donc son futur sang-froid. Elle doit être très visible, et le mieux en couleur, c’est le jaune. Elle est militante, auprès de la jeunesse qui aime les couleurs sombres, entre chien et loup sans lumières, casquée d’écouteurs3 et basta ! Des mouvements citoyens se sont organisés et créent des événements festifs afin de dénoncer le danger de ceux qui par nécessité écologique souhaitent que des structures fiables pour les deux-roues soient créées4, mais loin d’être la priorité, leurs éventuelles réalisations ne sont que mesurettes pour bonne conscience. La bicyclette doit être avant tout un art de vivre, qui refuse de se cantonner au loisir et au sport, pour ceux qui feraient l’effort d’aller au travail avec celle-ci5, contrairement à ce jeune employé de banque qui, habitant à moins d’un kilomètre de son lieu de travail, ne peut accueillir le client « tout auréolé de transpiration et puant ». L’Hommauto est indéboulonnable !
Rémy Roussille
1. Mouvement citoyen militant pacifiste de Seattle.
2. Bernard Charbonneau, L’Hommauto, Paris, Denoël, 1967, rééd. 2003.
3. L’amende pour port d’écouteurs à vélo est de 135 euros.
4. Copenhague possède plus de 400 kilomètres de pistes cyclables, et deux habitants sur trois n’ont pas de voiture.
5. Mesures gouvernementales, réductions d’impôts pour les employeurs, et primes pour les employés ? À suivre...
Point de vue 20 : Décembre 2019
Loin de la France métropolitaine, début 2018, un « nouveau concept pour dynamiser Tahiti » fut d’envisager de construire un « Village tahitien ». Cela semble à l’évidence quelque peu anachronique quant on connaît toutes les transformations qu’a subies ce territoire. Cet exemple n’est pas le seul, comme lorsqu’on crée des centres culturels dans des endroits très isolés en Nouvelle-Calédonie, qui restent malgré tout peu fréquentés. Si cela est assez surprenant, il serait possible de multiplier les cas où l’appel au « patrimoine » devient systématique. Par exemple, lorsque le maire d’une ville moyenne, dans un éditorial, cite six fois ce terme en une dizaine de lignes. Revenons alors sur quelques points.
S’agissant du patrimoine matériel, les objets les plus modestes ou les plus familiers de notre quotidien peuvent faire sens. Le petit patrimoine, ou le banal et le quotidien peuvent être valorisés tout autant que les plus grands chefs-d’œuvre de l’architecture et des beaux-arts. Ce patrimoine peut être composé de jouets, d’outils ou d’albums photos. Des biens tels que les lavoirs, les fours à pain peuvent être reconnus comme patrimoine. Celui-ci peut mobiliser des associations ou des groupes particuliers. Les écomusées sont soutenus localement, constitués par les habitants et les ressources du cru. Cependant, lorsque le patrimoine s’institutionnalise, les pouvoirs publics sont cantonnés à la seule existence d’aides. Le « patrimoine culturel immatériel » signifie quant à lui la sauvegarde d’une croyance, d’un rite, d’un folklore, d’une langue ou d’une pratique ancestrale. Il peut également concerner des lieux ou des espaces particuliers, « façonnés par l’activité humaine ». L’Unesco, agence spécialisée de l’ONU, contribue ainsi à préserver le patrimoine culturel des territoires qu’il qualifie de mondial. Il désigne un ensemble de biens culturels ou naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Dans le monde, mille cent vingt et un biens culturels, naturels ou mixtes sont classés par cette organisation, dont quarante-cinq en France. Si tout cela permet de revisiter certains imaginaires, plusieurs effets redoutables ne sont-ils pourtant pas à craindre ? Le risque n’est-il pas grand de ne réduire ce patrimoine qu’à certains points de vue ?
Le premier problème renvoie au lien entre la valorisation d’un patrimoine et l’activité touristique. Contrairement à certains sites qui ne sortent pas de leur isolement, d’autres subissent de plein fouet les effets néfastes du tourisme de masse. La mobilité touristique incessante ou envahissante, en périodes estivales, non seulement est source de pollutions, mais finit aussi par tuer la vie locale, comme pour le cirque de Gavarnie. D’ailleurs, dans le monde, cinquante-trois sites inscrits sont en péril, et certains pour cette raison. Ainsi, en dépit des prétentions de l’Unesco, selon lesquelles le patrimoine serait garant du développement durable, terminologie bien en vogue, c’est paradoxalement l’inverse qui se produit. Mais un autre problème apparaît lorsqu’on souhaite créer de toutes pièces un site, qui ne fait que justifier le dépérissement d’une culture du fait de l’obligation de préservation qu’il connote. Le patrimoine tend dès lors à se réduire à une simple « vitrine identitaire », avec le danger que celui-ci n’ait plus qu’une portée politique et/ou religieuse. Alors que la notion de patrimoine génère une énergie énorme, il risque de n’être utilisé que pour faire valoir la prééminence de quelques valeurs ou croyances à des fins essentielles d’« expansionnisme pastoral ».
Aussi, il ne suffit pas de construire, il faut inventer de nouvelles formes d’attractivité. Or certains individus, qui se disent « experts », à qui la patrimonialisation promet une forme d’éternité, ne souhaitent-ils pas eux-mêmes être qualifiés de « patrimoine » ou de « trésor humain vivant » ? Cependant, sans dentelle, sans costume, sans berger, sans temple ou sans forces vives, ces trésors ne sont que peu de chose.
Corinne BERGER
Point de vue 21 : Mars 2020
Peu de personnes ont remarqué que nous étions face à une épidémie, non pas de peste noire ou bubonique, de tuberculose, de rougeole ou autre, mais de mots-valises. Prenons un premier fait. Que ce soit l’épicier du coin, le buraliste, l’étudiant ou l’élève, l’expert en relations internationales, le commentateur ou le ministre, que cela se passe dans les discussions au café du Commerce ou dans les réunions de toutes sortes, que ce soit à Limoges, Brest, Nîmes, Nouméa ou Papeete, tous les individus abusent du même bouche-trou : « du coup ». Employé n’importe où et n’importe quand, sans qu’on perçoive son sens véritable et son utilité, « du coup » se propage partout par effet de mode. Le souci est qu’il n’y a malheureusement pas que cette expression.
Dans les années 1980 et celles qui ont suivi, le terme de « projet » a tout envahi, sans savoir si l’on faisait allusion à des intentions, des aspirations, des buts ou des objectifs. Encore aujourd’hui, il existe bien une orgie de projets, qu’ils soient d’orientation, de formation, d’aménagement, de développement, de retraite, de loi, et j’en passe. Puis, en 1990, c’est celui de « proximité » qui est venu sur le devant de la scène. Il fallait une médecine de proximité, une éducation de proximité, une police de proximité, des commerces de proximité, et j’en passe encore. Aux confins des années 2000, tout devait devenir « durable » (voir Lettre n° 33), les produits, les relations, les politiques… Lors d’un entretien avec un maire élu depuis plus de trente ans, celui-ci a dit sans ambages : « Moi, je fais de la politique durable. » À l’époque, de grands panneaux publicitaires ornaient les routes du Languedoc-Roussillon, où il était écrit en gros caractères : La Région investit pour vous. Elle fait des routes durables, et j’en passe une nouvelle fois.
Actuellement, c’est la terminologie de « transition écologique » qui s’invite. Cela signifie le passage d’un état à un autre ou, d’après Rob Hopkins, la prise de conscience et la volonté d’agir concrètement. Or, comme tous les autres termes cités plus haut, ce dernier vocable est récupéré par tout un chacun, ce qui n’est pas spécialement un mal en soi, mais lui fait perdre petit à petit sa signification originelle. Au cinéma, par exemple, j’ai été stupéfait de constater, à plusieurs reprises, lors des publicités dont on nous matraque avant la projection d’un film, que cette idée était bien en vogue. Toutes ces annonces avaient, semble-t-il, le même fonds de commerce. Qu’elles fassent la promotion de meubles, d’équipements vidéo ou audio, de chauffages ou de climatisations, de restauration rapide, de piscines ou de spas, et même d’automobiles, toutes s’inscrivaient dans la défense du climat et de l’environnement, sous couvert bien sûr de transition écologique. Les publicitaires ont ainsi trouvé là un bon filon et en feront usage, je suppose, pendant longtemps encore, pour valoriser le seul pouvoir qui reste, à savoir le pouvoir d’achat. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant qu’on en arrive à des absurdités telles que la promotion de voitures électriques ou des derniers avatars de la téléphonie mobile, exploitant et utilisant des terres rares, tout en vantant bien sûr les bienfaits de la transition écologique, ou encore la construction de piscines chauffées dans de petites communes de montagne pour attirer les touristes, tout en stoppant l’éclairage public après 23 heures afin de s’en tenir naturellement à cette transition.
Mais alors, tous ces mots ne sont-ils pas en définitive que des objets fétiches, tout comme les poupées de chiffon dont les enfants se servent pour se réconforter et se rassurer, « du coup » ?
Jean-Luc Roques
Point de vue 22 : Juin 2020
Dans une société de l’effervescence, des flux incessants, il est difficile d’imaginer vivre à l’arrêt. L’immobilité est considérée comme une perte de temps, lorsqu’elle n’est pas synonyme de mort. Or, en l’espace de quelques semaines, les humains se sont retrouvés dans l’impossibilité de se déplacer. Ils ont trépigné dans leur cuisine et sont restés, durant des semaines, rivés à un écran, évoluant dans un univers virtuel. Si les théories libérales insistent sur le terme d’adaptation, ne faut-il pas aujourd’hui envisager une autre façon de se comporter ? Et pourquoi ne pas faire l’éloge de l’immobilisme ?
D’après une image, véridique ou inventée, les hommes ont pendant longtemps privilégié le calme et la quiétude. Ils avaient coutume de se déplacer uniquement pour leur survie, en quête de nourriture et d’échanges. Ils étaient aptes à passer de longs moments à l’affût, cachés, afin d’observer chaque mouvement de la nature. Ils ont vécu de cette manière pendant des millénaires. La chasse, la cueillette ou la pêche relevaient d’une pratique et d’une observation minutieuses. D’autres moments étaient consacrés au repos, à la pause et à la palabre. Les Indiens, les Kanaks, les Inuits, par exemple, vivaient des ressources de la forêt, de l’eau et de la terre généreuse. Ils passaient du temps à regarder le feu. Ils partaient à la rivière pour se baigner et restaient à discuter dans l’eau des heures entières. Ils pouvaient attendre plusieurs jours qu’un poisson morde à l’hameçon. La réalité historique est venue pourtant fracasser cette représentation. À propos de la conquête du Nouveau Monde par les Européens, Jean-Christophe Rufin, dans son roman Rouge Brésil, écrivait : « Ce n’est pas l’homme qui a été chassé du paradis terrestre, mais Dieu. Et l’homme s’est emparé de la création, pour la détruire. » Dans cette logique, il n’y a rien de plus difficile désormais que de « rester immobile », quel que soit le milieu, urbain ou rural.
Pourtant, cette attitude d’immobilité pourrait signifier, simplement, être attentif-ve aux autres, à ce qui est extérieur à soi, et induire une façon de contempler les choses pour y trouver une harmonie. Être capable de s’asseoir à l’ombre d’un mur pendant des heures entières, de reconnaître le chant des oiseaux, les sentiers, les plantes ou les odeurs, et ce qui naturellement imprègne. Il ne s’agit pas ici de retourner aux arbres, mais simplement de les écouter. C’est être aussi capable de porter un autre regard sur les monuments, les façades, les fontaines, les rues ou les pierres. En cela, les humains pourraient mieux appréhender tout ce qu’il y a d’enveloppant et de doux dans ce monde. Ils pourraient sans doute mieux respecter et protéger ce qui ne se réduit pas à leurs seules activités. Au lieu de faire non pas deux minutes de silence, il faudrait plutôt qu’ils en observent, chaque jour, quelques heures. Si, au lieu de faire l’éloge du mouvement, ils faisaient celui de la lenteur, de la patience et de l’inactivité, imperceptiblement se produirait sans doute une nette transformation. Et s’ils pouvaient comptabiliser ces moments paisibles et en faire un indicateur du produit intérieur brut, un monde ralenti et certainement beaucoup plus riche adviendrait.
Après l’extinction des dinosaures, ce sera probablement au tour de l’homme de disparaître, et cela plus rapidement qu’il n’y paraît. On pourrait d’ailleurs reprendre le titre de l’ouvrage du philosophe Yves Paccalet : L’Humanité disparaîtra, et son sous-titre : bon débarras !. Confrontées aux catastrophes qui nous menacent et qui seront, à terme, de plus en plus fréquentes, nos sociétés demeurent atteintes de « pléonexie » et de cupidité. Pourront-elles changer les choses ? Il n’est pas interdit de se poser la question et/ou de se laisser aller à la rêverie.
Corinne BERGER
Point de vue 23 : Septembre 2020
En mars 2018, était lancé, par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, un programme intitulé : « Action cœur de ville ». Le but était d’améliorer les conditions de vie des habitants de villes moyennes, mais aussi de conforter le rôle important de ces entités urbaines dans le développement des territoires. Deux cent vingt-deux communes ont été éligibles. En effet, le constat était assez amer, puisque ces villes avaient des difficultés d’attractivité, des logements dégradés ainsi qu’une vitalité commerciale en berne. Il est vrai que la situation n’est pas très réjouissante. Dans certaines de ces villes où j’ai pu me rendre, il y a bien une désertification totale des rues et du bâti, et parfois de grandes photos de terrasses de cafés ou de passants sont affichées de façon pathétique sur les devantures d’anciens magasins fermés, en proie à la décrépitude. Dans ces espaces vides, quelques personnes âgées ou des familles pauvres tentent encore de vivre.
La question est de savoir comment nous en sommes arrivés là, et cela en quelques années seulement. Pourquoi tous ces centres-villes sont-ils aussi désolés ? Il serait possible d’invoquer une multiplicité de raisons, mais j’en remarque une qui me semble assez sensible. Pour cela, il faut tout de même faire un petit rappel concernant les politiques urbaines et leur transcription au niveau local. En 1967, le plan d’occupation des sols (POS) était élaboré et approuvé par les services de l’État. Le 7 janvier 1983, sous le couvert de la décentralisation, qui devait régler tous les problèmes et rapprocher les citoyens des décideurs, cette compétence a été transférée aux élus locaux, avec avis des services de l’État. Avec la loi SRU de 2000, le plan local d’urbanisme (PLU) a remplacé le POS et, en 2011 et 2014, le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) pouvait permettre de rationaliser les constructions et limiter la concurrence entre les territoires. Or, quelle que soit la formule, par un phénomène d’imitation généralisée, que l’on retrouve, en France, de Brest à Menton ou de Strasbourg à Biarritz, les élus de toutes ces villes n’ont eu de cesse d’étendre les zones à urbaniser. Soit par cupidité, soit par maladresse ou niaiserie, ils n’ont eu comme seule ambition, pour développer leur cité, de mettre en place de vastes centres commerciaux, d’encourager l’implantation de lotissements en périphérie, mais surtout de vider les bourgs-centres.
Pourtant, depuis des décennies, les appels et les études ont été nombreux concernant cette absurde gestion du territoire. Plus récemment encore, le 21 juin 2020, la convention citoyenne pour le climat pointait, dans son rapport, qu’il fallait maîtriser cet étalement urbain. Dans sa proposition SL3-11, elle insistait sur la nécessité de sensibiliser à l’importance de la ville compacte et d’éviter toute implantation dans des zones naturelles. Or, s’il ne fallait citer qu’un exemple, je prendrais celui de la commune de Fournès, dans le Gard, avec son projet de construction d’un centre de tri de colis de 39 000 mètres carrés sur un terrain de quatorze hectares, pour l’entreprise Amazon. Cette station logistique serait l’une des trois plus grandes d’Europe, avec le passage de 500 camions par jour. L’entreprise Argan, qui s’occupe du dossier, faisait d’ailleurs miroiter en 2018 la création de 600 emplois (qui se réduisent en 2020 à 150), ainsi que des rentrées fiscales conséquentes pour que la commune puisse, au lieu de penser, dépenser. Ainsi, les élus locaux (sans parler des prises illégales d’intérêts qui ont été mises en évidence) continuent inlassablement dans la même direction, favorisant toujours un esprit clientéliste.
Cet exemple n’est pas isolé, mais est typique de cette gestion délétère par des édiles locaux imbus d’un pouvoir qu’ils pensent définitivement acquis au sein d’une démocratie qui se réduit au seul jour d’une élection. Ces derniers se plaignent maintenant, mais un peu tard, de la mort de leur centre-ville.
Jean-Luc Roques
Point de vue 24 : Décembre 2020
Lors des élections municipales de 2020, j’ai demandé à une personne pour qui elle allait voter. Sans détour, elle m’a dit qu’elle allait donner sa voix à « untel » et a ajouté avec une certaine franchise : « Mais tout le monde sait que c’est un menteur. » Cette affirmation surprenante ne renvoie pourtant en rien à un électeur isolé. En effet, un sondage Ipsos montrait que, sur un ensemble de catégories, les hommes politiques étaient les plus soupçonnés de mentir. Les escrocs les plus habiles et redoutables ne sont-ils pas ceux qui parviennent à camoufler leurs ruses derrière un masque d’humanisme, de sympathie et d’honnêteté ? Si, par définition, le mensonge est un discours contraire à la vérité, dont le dessein est de tromper, pourquoi alors donner sa voix à ce candidat ?
Le menteur est celui qui persuade l’autre de sa sincérité. Dans une partie de poker, ce sont les meilleurs joueurs qui savent duper l’adversaire. Mais, dans le jeu démocratique, est-il permis de tromper l’électorat ? La force de persuasion d’un seul, même s’il ment, peut faire varier les opinions des autres. Le menteur par ruse peut faire rêver l’électeur. Il recourt à des procédés pour, comme écrivait Machiavel, « endormir la cervelle des gens », avec des mots tels que solidarité, bien-vivre ensemble, égalité ou fraternité. Ainsi, il agit comme le serpent Kaa, du Livre de la jungle, qui dit à Mowgli : « Aie confiance, crois en moi… »
En définitive, notre électeur, en donnant sa voix, cautionne un type de comportement fondé sur des inventions, de fausses idées ou toutes sortes de calomnies infondées. Ainsi, à offrir une forme de légitimité aux mensonges, aux fourberies, aux tricheries, nous en arrivons à des situations dramatiques. Le 5 février 2003, Colin Powell, au siège de l’ONU, alors secrétaire d’État américain nommé par un président élu, expliquait : « Il ne fait aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques […]. Nous avons une description de première main. » Or ce type de mystification ne fait à son tour que gangrener, par effet boule de neige, tout le reste. L’industrie du tabac falsifie les données sur la nocivité de son produit. Les entreprises d’extraction des ressources naturelles, avec l’aval des « climato-sceptiques », travestissent régulièrement la véracité de faits concernant les pollutions ou le réchauffement climatique.
Pour revenir à notre électeur, il faut pourtant envisager autre chose. Celui-ci se soucie-t-il vraiment des promesses, des projets, des intentions liés à la campagne de son candidat ? Se pose-t-il véritablement la question de son intégrité ou de son honnêteté ? Peut-être notre électeur envisage-t-il de voter pour tel candidat, car il espère à l’issue de l’élection en tirer des avantages personnels pour lui ou ses proches. D’ailleurs, les associations ou les entreprises vassales, qui gravitent dans cet univers, en connaissent bien les rouages. Dès lors, le clientélisme est en grande partie fondé sur un principe de dupe : « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. » Voilà malheureusement une logique qui ne surprend plus personne, ni l’électeur ni le menteur lui-même.
Dans toute cette histoire, on peut remarquer que les menteurs eux-mêmes sont amenés à croire à leurs menteries. Par effet d’entraînement, le mensonge ne devient-il pas inséparable du pouvoir et de la puissance ? Toutefois, on peut se demander si, dans notre démocratie représentative, tout le monde ne marche pas dans la même combine. D’ailleurs, tout le monde attend avec impatience les élections afin non pas de défendre le bien commun, mais d’en tirer quelques petits bénéfices et arrangements privés. Dans ces conditions, que faut-il alors condamner, le mensonge en tant que tel ou une élection qui stimule le mensonge ? Surtout, n’allez pas me croire !
Corinne Berger
Point de vue 25 : Mars 2021
Je veux présenter ici mon sentiment par rapport à ce que j’entends dans les médias, avec comme titre à la Robert Louis Stevenson : Mister Covid et Docteur Français, ou Du paradoxe français face à la crise sanitaire.
La France, comme tous les pays du monde, doit affronter une crise épidémique et sanitaire. La conjoncture est d’autant plus inquiétante et déstabilisante que l’on a affaire à un virus de type Corona particulièrement complexe à maîtriser. Face à ces moments plus que délicats, la France fait exception. En effet, tout le monde est médecin ou plutôt épidémiologiste, virologue ou infectiologue, comme tout un chacun est aussi sélectionneur de l’équipe de France de football. Ainsi, la situation actuelle engendre une formidable cacophonie dans laquelle il est particulièrement difficile de se fixer des points de repère stables. Si bien que, au sein d’une large partie de la population, se développe un sentiment d’insécurité, d’incertitude, voire d’angoisse.
Souvent, dans les sociétés démocratiques, on a tendance à oublier que, si les droits fondamentaux sont garantis, un certain nombre de devoirs s’imposent à tous. C’est ce qu’on appelle le civisme. Face à une crise de cette ampleur, la cohésion sociale doit primer et non l’individualisme, hélas inhérent à la mentalité hexagonale. Un sondage Ifop de mars 2020 montrait que 64 % des Français pensaient que le gouvernement gérait mal cette crise. La notion du « faut qu’on, y a qu’à » bat son plein, et tous (hommes ou femmes de l’opposition politique) sont sûrs de posséder la solution idéale et magique pour venir à bout des problèmes. Pour faire oublier leur absence d’arguments ou de solutions constructives, ils ou elles se contentent de mettre en avant les erreurs du gouvernement : l’absence initiale de masques, la mauvaise gestion des tests et la lenteur de la campagne de vaccination. Cependant, quand on y réfléchit, on peut trouver une certaine simplicité dans ce brouhaha médiatique. En effet, comment préserver la santé de la population tout en évitant un désastre économique et social ?
L’autre idée fréquemment rabâchée, en ce moment, est celle de l’infantilisation, avec des assertions comme : « Le gouvernement, le président nous infantilisent. » Docteur Français accepte volontiers les aides de l’État-providence mais en même temps refuse, à quelques exceptions près, d’être solidaire face à la crise. Tout est donc sujet à controverse. Les efforts de l’État sont acceptés, mais chaque décision gouvernementale est critiquée et remise en cause pour ses insuffisances. Ceci illustre assez bien ce paradoxe français : acceptation du soutien de l’État, mais en même temps critique des mesures prises par l’exécutif. Ainsi, à la suite du premier confinement de 2020, des millions de Français sont partis en vacances s’entasser sur les littoraux, en oubliant de manière un peu déraisonnable les mesures sanitaires les plus élémentaires, recommandées pour autant par la communauté scientifique. S’en sont évidemment suivis un confinement partiel, mais aussi un nouveau tollé général et un flot de critiques. Le proverbe de Philippe Néricault, au xviiie siècle, ne prend-il pas tout son sens : « La critique est aisée mais l’art est difficile » ?
Cette crise impose à tous plus de responsabilités, plus de solidarité et un peu plus de conscience civique. L’individualisme est une attitude inhérente à notre société mais, en ces temps, ne paraît-il pas plutôt malvenu ? Dans ce contexte délicat, il est évident que nous devrions nous référer à René Descartes qui écrivait au début du Discours de la méthode : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Toutefois, on peut craindre que, en matière de comportement humain (français en particulier), il se soit montré un peu trop optimiste.
Pascale Berger
Point de vue 26 : Juin 2021
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais le nec plus ultra n’est plus au chien unique. Le maître doit en posséder plusieurs. Les modes changent et, à ce que l’on prétend, il est nécessaire d’imiter son voisin.
Le chien est certainement le premier animal à avoir été domestiqué, il y a quinze mille ans, même si de nouvelles sources font remonter ce phénomène à quarante mille ans. Au cours du temps, le chien a eu de multiples fonctionnalités pour la chasse ou la défense, pour les courses ou les combats. Il est présent dans les mythes tant indo-iraniens que grecs, dont le plus connu est Cerbère. Il a été utilisé comme mets de cuisine, et les Gaulois en étaient d’ailleurs très friands. On dit que le chien est le meilleur ami de l’homme. En effet, parmi toutes les fonctions canines, celle du lien social est la plus souvent admise, unissant l’humain à l’animal. En ville, le chien est devenu un vecteur d’interaction, notamment dans cette foule solitaire dont parlait David Riesman. Il permet de débuter une conversation entre citadins : « Quel âge a-t-il ? » « Quel est son sexe ? » « Quelle est sa race ? » « Qu’il est mignon ! » Etc. Si la situation se renouvelle, et c’est souvent ce qui se passe, les rapports deviennent plus intimes : « Que mange-t-il ? » « Est-ce qu’il dort bien ? » Etc. Parfois, les rendez-vous ont été ratés. Dans ce cas, j’ai entendu lors d’une rencontre : « Oh ! je ne l’aurais pas reconnu ! » Le chien facilite dès lors la liaison, jusqu’au moment où il sera laissé pour compte. Environ cent mille chiens et chats sont abandonnés par an en France, alors qu’en Angleterre un propriétaire sur cinq souhaite actuellement s’en débarrasser. Toutefois, n’avons-nous pas là qu’une partie de l’iceberg ? Revenons alors sur la domestication.
Le chien est convoité parce qu’il permet une appropriation afin de le contrôler. La rencontre n’est-elle pas ici sous-tendue par un autre rapport, celui de supérieur à inférieur ? Au xiie siècle, le mot « lien » désignait la laisse du chien, et en gascon il avait pour signification la chaîne. Les expressions telles que « Ne tire pas sur cette laisse », « viens ici », « couché, debout, assis » engendrent parfois brimades et coups. Ce lien semble écraser et exiger la soumission. Le chien se transforme alors en objet de subordination et permet au maître d’avoir ce sentiment d’être reconnu comme le chef.
Mais la domestication ne renvoie-t-elle qu’au seul contrôle, puisque le chien doit également rendre un service ou devenir un bien de consommation ? Sans être cynique, le chien a aujourd’hui une utilité dans la croissance économique, puisqu’il stimule en effet le PIB et favorise l’emploi. Il permet de produire des croquettes, des boîtes (chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en France) et des sacs plastique d’hygiène canine (seize tonnes d’excréments à Paris par an), de construire des canisites, d’employer des agents de nettoyage, de faire travailler des vétérinaires, des vendeurs de vêtements et d’ustensiles, ou des shampouineurs, de recruter des avocats en cas de plaintes. Mais la logique du marché ne s’arrête pas là, quand les innovations et l’intelligence artificielle s’en mêlent. Après avoir pris le corps, il ne restait plus qu’à prendre l’âme de cet animal. Si le chien robot « Spot » de la société Boston Dynamics a été (lâchement) abandonné par la police des États-Unis, le robochien (d’après la formule) chinois « Alpha-Dog » a un bel avenir devant lui. D’après ses concepteurs, il pourra être utile dans le cas de handicaps et disposera d’une personnalité au choix du client. « Alpha-Dog » court à quinze kilomètres à l’heure, est doté de capteurs et évolue dans son environnement grâce à la 5G. Pourtant, si le chien aboyait ou levait la patte, ses deux concurrents n’ont ni queue ni tête et ne peuvent pas grogner.
Une chienne de vie en perspective.
Jean-Luc Roques
Point de vue 27 : Septembre 2021
Le mot « liberté » résonne aujourd’hui dans bien des endroits, mais aussi à tout-va. Le professeur de droit François Terré écrivait d’ailleurs, il y a déjà quelques années : « Sous le pavillon de cette liberté vinrent se ranger de nouvelles exigences. [...] Et l’on ne s’arrête pas là. Devenue prétexte à la manie de la revendication, ce mot magique de liberté peut couvrir toutes les outrances. Pourquoi pas le droit au soleil ou, si l’on craint de bronzer, le droit à la pluie ? » Le droit de manifester, le droit de s’exprimer librement, le droit de descendre dans la rue sont honorables, sauf que…
Si la liberté est bien fragile, sa signification semble de nos jours s’appauvrir et ne se réduire qu’à quelques notions, comme celles d’intention, de projet, de motif et de volonté. Les révolutionnaires de 1789 seraient d’ailleurs bien surpris de voir à quel point l’idée s’est réduite à de simples aspirations, comme le droit d’aller au cinéma ou au restaurant, celui d’avoir un téléphone portable avec accès illimité ou de se déplacer partout dans le monde sans contraintes. Ainsi, on voit là un aboutissement de droits et libertés révolutionnaires bien loin des objectifs de leurs concepteurs. En définitive, l’individu se désigne comme le détenteur exclusif de ces droits et déclame sans retenue aucune : « Je suis libre de faire ce que je veux. » Dans un documentaire réalisé par Lucy Walker sur les incendies en Californie, celle-ci montrait que, dans certaines communes, les habitants avaient refusé la proposition d’augmenter les impôts pour embaucher plus de pompiers, dont l’effectif était insuffisant, et que, dans d’autres endroits, ils avaient écarté la solution qui obligeait les riverains à défricher un espace de 1,5 mètre autour de leurs maisons. Il n’y a pas qu’aux États-Unis, malheureusement, que ce comportement prévaut. La zone située autour du Vésuve, autre exemple, est déclarée parc naturel depuis 1995. Or les autorités italiennes font face à de grandes difficultés qui proviennent du non-respect des lois interdisant la construction de bâtiments sur ce site. Non seulement les habitants ne souhaitent pas changer leur comportement mais, de plus, personne n’est en droit de leur demander de faire quoi que ce soit. Ainsi pensent-ils qu’eux seuls détiennent la vérité : « J’ai raison ! » L’idéologie individualiste n’est-elle pas passée par là, avec un chacun pour soi et rien pour les autres, avec aussi l’idée de propriété individuelle, « inviolable et sacrée », les détachant de tout ce qui les entoure.
Il me semble que la liberté, ce n’est pas cela. L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Cela signifie non seulement qu’une action intentionnelle peut s’avérer absurde, mais encore que l’autre n’est pas qu’une chimère. En effet, autrui, dans cette liberté, existe pareillement. Quitte à être simpliste, il est bon de rappeler que l’homme est un être social. Si l’individu est amené à vivre avec les autres, cela suppose, pour être libre, qu’il puisse résister à la tentation de l’égoïsme. Ainsi, être libre, ce n’est pas faire n’importe quoi, c’est surtout avoir la capacité de se rendre indépendant(e) de ses propres désirs et de reconnaître une norme ou une valeur. Le philosophe Alain rappelait d’ailleurs à ce titre : « La liberté ne va pas sans ordre. »
Pourtant, le risque est assez redoutable de n’avoir plus devant les yeux qu’une société atomisée, une sorte d’agglomérat d’ermites séparés par des barrières infranchissables, chacun d’eux brandissant le drapeau Liberté !. Tout cela pour en arriver, en fin de compte, à un danger paradoxalement encore plus grand, celui d’un système totalitaire.
Point de vue 28 : Novembre 2021
Généralement un temps d’attente trop long, et cela quelque soit la situation, exaspère, et peut même devenir très irritant. Ce phénomène est globalement valable pour tous. En revanche, faire attendre n’est-il pas un moyen de servir les intérêts de certains ?
Prenons le cas des COP (Conférence des parties) qui, en 1995, se réunissait pour la première fois à Berlin. En 1997, le protocole de Kyoto fut signé lors de la COP3, et fut considéré comme « une grande avancée ». En 2015, la COP21, à Paris, a été décrite comme un « moment historique », réunissant plus de 40 000 personnes venant du monde entier. L’accord signé par 196 pays a été applaudi par les membres de l’assemblée présente, et certains pleuraient d’émotion. Puis ont suivi les autres COP dont les relais médiatiques furent plus ou moins soutenus. En novembre 2021, environ 30 000 personnes étaient présentes à la COP26 de Glasgow qui était décrite comme « cruciale ». Un des objectifs étant que chaque pays devait présenter ses contributions déterminées actualisées au niveau national (NDC). On pourrait supposer que grâce à cet imposant dispositif les émissions de gaz à effet de serre (EGES) devraient décroître substantiellement. Or, années après années, la situation se dégrade. L’Agence internationale pour l’énergie (AIE) ou le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), ne cessent de montrer que la tendance est à l’augmentation constante de ces émissions. En juin 2021, l’observatoire Mauna Loa, à Hawaï, relevait même qu’un nouveau record de concentration de CO2 dans l’air était dépassé. La barre des 419 parties par million (ppm), unité de mesure pour quantifier la pollution de l’air avait été franchie. Ce taux était comparable à ce qu’il était, il y a environ 4,1 millions d’années, lorsque le CO2 était proche de 400 ppm. Peter Tans, scientifique à la NORA, expliquait que « nous ajoutons environ 40 milliards de tonnes de pollution au CO2 dans l’atmosphère chaque années ».
On l’aura compris, il existe ici un bien curieux paradoxe, et la question de l’efficacité de ces COP pose véritablement question. Surtout que l’on sait qu’il existe des forces d’inertie extrêmement puissantes, comme l’égoïsme des Nations, les résistances de grand groupe ou celles des pouvoirs économiques et financiers, mais aussi l’appétence des populations à vouloir continuer de consommer. On peut comprendre que cela puisse se transformer en grogne. Toutefois, ce ne sont pas les manifestations, les hurlements ou les incantations pour la mise en place d’un Green New Deal qui modifient la situation. S’il semble difficile de bouleverser la tendance pourquoi dès lors faut-il continuer d’organiser ce type de conférence ?
Afin de répondre, en partie, à cette question, il est peut-être nécessaire d’inverser l’équation. L’augmentation des EGES, et le dysfonctionnement atmosphérique qui en résulte, tend en définitive à justifier ce type d’organisation. De ce fait, c’est l’intensification du problème qui offre une légitimité à ces grand-messes et leur cénacle. Comme ces conférences sont médiatisées à outrance, les participants y sont vus et acquirent une certaine reconnaissance (même s’ils sont critiqués), amplifiant ainsi l’attente que l’on porte à leur égard. Puisqu’ils affirment être à la pointe du combat et lutter contre les forces infernales, n’en retirent-ils pas un certain prestige ? Feront-ils alors apparaitre une fumée qui sera blanche et le monde sera sauvé, ou sera-t-elle noire et la planète tombera dans les bras de Satan, le Prince de l’air ? Ainsi, comme naguère, pour éviter l’apocalypse, on attend de ceux-ci un miracle. En conséquence et pour le dire un peu crûment, ces grands prêtres ont-ils intérêt à ce que cela change ? On peut en douter, puisque si cela devenait le cas, ils disparaitraient de la scène, et ne pourraient plus dire « il faut se revoir à la COP suivante ».
Jean-Luc Roques
Point de vue 29 : Mars 2022
Qu’est-ce-que l’engagement ? Il est avant toute chose une promesse et, plus généralement, la manifestation de volonté par laquelle une personne s’oblige. Dans le cadre d’une collectivité locale, espace public par excellence, il impose aux élus certaines obligations et non des moindres.
Un article du Canard enchaîné qui nous a été envoyé par un de nos amis lecteurs, reprenait, il y a quelques semaines, un rapport de la Cour des comptes. S’agissant de la construction d’une piscine, à Libourne (Gironde), son coût est passé de 28,7 millions d’euros à 39,4 millions. À Châteauroux (Indre), le coût prévu pour la même opération était de 29,7 millions d’euros et est passé à 47 millions. Un terrain de foot, à Borgo (Haute-Corse), a coûté 10 fois son évaluation initiale. La médiathèque de Condé-sur-l’Escault (Nord) a coûté 4,7 millions, pour seulement 643 lecteurs. À Niort (Deux-Sèvres), un parking de 500 places a été construit pour la somme de 13,8 millions d’euros. Or, celui-ci étant surdimensionné, avec des places inoccupées, la commune doit prélever chaque année 0,7 million sur son budget pour équilibrer ses comptes. On peut admettre qu’il existe toujours des turpitudes décisionnelles inhérentes à toute gestion locale. Toutefois, ces seuls constats, qui pourraient d’ailleurs être multipliés, mettent en évidence un net décalage entre la dépense envisagée et celle finalement facturée. Si diverses causes ou raisons peuvent être invoquées, il est pourtant aisé de constater que les engagements budgétaires pris ne sont pas tenus, alors même que les discours récurrents des édiles se fondent sur le mot magique d’« engagement ».
Au plan environnemental, prenons l’exemple d’une forêt de 337 hectares sur le point d’être supprimée. En 1993, la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac, dans le Gard, a classé cet espace boisé (EBC). Ce choix délibéré avait pour objectif de protéger la biodiversité. Pourtant, en 2021, la municipalité a souhaité son déclassement, arguant que cela avait été demandé par l’État et le département. Cela donnerait ainsi la possibilité d’étendre une urbanisation sans contraintes. Au-delà de l’argumentation fallacieuse, il est important de considérer que cette simple décision est en grande partie incompréhensible. Non seulement elle manque de lisibilité (sauf bien entendu pour ceux qui en tireront quelques bénéfices et profits), mais elle sous-tend une forme d’inconsistance, voire d’irresponsabilité, et surtout discrédite un engagement pris trente ans plus tôt. Si, comme le suggérait Jacques Donzelot, on transfère des compétences « à des élus qui n’y connaissent rien », on peut dire aussi qu’ils ne font pas grand-chose pour inverser la tendance.
Entre les problèmes d’engagements qui ne sont pas tenus et les décisions difficiles à saisir, il est donc logique que cela débouche sur de nombreuses interrogations relatives à la gestion des collectivités. Ainsi ne faut-il certainement pas s’étonner s’il existe une coupure de plus en plus nette entre les membres de la société et les élus locaux, qui sont malgré tout censés les représenter. Plus grave encore, cette situation ne favorise-t-elle pas la montée de doctrines de plus en plus antidémocratiques ? Il n’est pas question ici de remettre en doute l’élection ni de jeter l’opprobre sur les élus locaux, même si d’autres types de procédures de représentation pourraient exister. En revanche, il serait raisonnable de reprendre, dans le cas des communes, le vocable de mayor domus. Celui-ci figurait en tête de la domesticité chez les rois barbares et était au service des autres. En effet, être représentant d’une collectivité, ce n’est pas avoir des droits supplémentaires sur les choses ou les habitants, c’est plutôt avoir des devoirs de justice et d’éthique supplémentaires.
Point de vue 30 : Juin 2022
Face à une inertie importante, le monde s’achemine vers une catastrophe écologique. D’ailleurs, le dernier rapport du GIEC de 2022 tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Les émissions de carbone nocives entre 2010 et 2019 n’ont jamais été aussi élevées. Les rapporteurs admettent que « c’est maintenant ou jamais » qu’il faut agir, puisque « nous sommes à la croisée des chemins ». Pour cela, ils préconisent quelques orientations. Les pays doivent rapidement revoir leurs politiques énergétiques et faire baisser l’utilisation des combustibles fossiles. Il est important de modifier les modes de vie et les régimes alimentaires, de changer les moyens de transport, de revoir l’isolation des habitations. Enfin, il est impératif de repenser intégralement l’espace urbain et favoriser l’émergence de « villes compactes ». Or par quel coup de baguette magique pourrions-nous sortir d’un tel marasme ?
Si l’on se concentre simplement sur cette idée de « ville compacte », quels en sont, en quelques mots, les grands principes ? Le but est, avant toute chose, d’éviter l’étalement urbain et de renoncer à construire des villes nouvelles. L’impératif est donc d’augmenter la densité de population, de desservir des quartiers à égale distance du centre, et ainsi de favoriser le déplacement pédestre. Tout cela devrait permettre de protéger les espaces naturels et de limiter la consommation d’énergie, source de multiples pollutions. Avant de poursuivre, il faut admettre que cette idée de ville compacte pose quelques interrogations. Si on évite qu’une ville s’étende, la population va progresser irrémédiablement et, mécaniquement, sa densité va s’accroître. De ce fait, l’urbanisation ne peut être qu’intensive. Il faudra détruire les petits immeubles ou les quelques maisons qui existent au centre-ville (voire dans les quartiers périphériques) et construire en hauteur. Il sera ainsi possible d’augmenter encore et encore le nombre d’habitants. Cependant, à vouloir construire toujours plus haut, le risque est que tout s’effondre.
Au-delà de ce point, qui reste tout de même conséquent, ce qui semble le plus perturbant, c’est surtout de regarder la manière dont a été conçu l’aménagement du territoire en France (ou dans d’autres pays). Il a été confié en grande partie aux communes, depuis les lois de décentralisation des années 1980, et a été élaboré de façon radicalement opposée à ce que proposent aujourd’hui le GIEC ou d’autres instances. En effet, des espaces naturels entiers ont été rongés, tout a été centré sur le transport automobile, avec comme conséquences non seulement de la pollution atmosphérique, mais aussi des déplacements pédestres totalement ridicules de la part des habitants. En effet, ceux-ci ne sont en moyenne que d’environ 500 mètres par jour. Quelle que soit la commune, du village à la grande ville, tout est constitué selon ce même schéma. Pourtant, la notion de « ville compacte » date du début des années 1970. Elle est donc bien antérieure à tout l’aménagement du territoire qui a été mis en place. Ce qui veut dire que, pendant près de cinquante années, on peut se demander quelle commune s’est véritablement emparée de cette idée, afin d’éviter les constructions anarchiques, la destruction des sols et les pollutions de l’air.
Tout cela est dans le fond très affligeant, surtout que, dans le cas de la France, les villages et les villes (petites ou grandes) disposaient naguère d’un bâti relativement serré, voire compact. Il existait, de plus, un maillage important entre les diverses entités urbaines. Aujourd’hui, la plupart des communes s’étalent et continuent de le faire, tout en pleurnichant sur la difficulté de gérer cette situation et en se lamentant de la désertification de leur centre. Mais, pendant ce temps-là, d’autres constatent leur dépérissement et attendent leur fin.
Point de vue 31 : Septembre 2022
Une chanson enfantine, qui a été reprise de multiples manières, raconte la chose suivante : « Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. » Elle se poursuit par : « C’est pas moi qui l’ai brûlée, c’est… [toujours quelqu’un d’autre]. » Puis ce refrain peut continuer. En d’autres termes, ce n’est pas de mon fait, ce n’est pas de ma faute si la maison brûle. Mais en quoi cette comptine pourrait-elle faire actuellement office de métaphore ?
On sait que la maison est en train de brûler de toutes parts. En 1998, Michael Mann a construit une courbe qu’il a appelée « crosse de hockey ». Grâce à celle-ci, il a mis en évidence l’évolution de la température de l’atmosphère. De l’an mil à 1900, il y a eu une relative stabilité de la température, avec quelques oscillations. Des réchauffements ponctuels, aux ixe et XIIIe siècles, et de petites ères glaciaires, aux XIVe, XVIe et XIXe siècles, ont eu lieu et duré quelques années. Cependant, une augmentation brutale est apparue à partir du début du XXe siècle, avec une hausse encore plus sensible au tournant des années 1980. Depuis le début des années 2000, le processus s’accélère, avec des vagues de chaleur qui ne cessent de s’accentuer chaque année, pour en arriver à celle de 2022. Les corollaires sont les incendies, la sécheresse et la pollution atmosphérique, sans parler des problèmes de santé, puis des inondations et des crues.
Puisqu’on subit de grosses chaleurs, on tente logiquement de s’en prémunir. Mais, de manière moins raisonnable, on en appelle plutôt aux brumisateurs, aux ventilateurs, aux rafraîchisseurs d’air ou aux climatiseurs. Le souci est que le phénomène ne peut que s’amplifier. Ainsi, au lieu de modifier substantiellement les modes de vie, on ne fait que renforcer le problème. Lorsqu’on prend simplement le cas des climatiseurs, on entrevoit toute l’absurdité du problème. Au début du xxe siècle, l’invention de la climatisation a suscité immédiatement l’engouement, tout d’abord dans les cinémas qui en ont fait la promotion, puis dans les magasins, les entreprises et chez les particuliers. Du fait des excès de chaleur, l’utilisation de la climatisation n’a fait que progresser. Depuis la vague de chaleur de 2003, l’Espagne, qui pourtant a toujours été habituée à se prémunir contre la chaleur, consomme plus d’énergie électrique en été qu’en hiver. En France, en 2017, les ventes de climatiseurs ont augmenté de 8 %. Si l’on s’en tient à certaines prospectives, ce marché va connaître les croissances les plus fortes dans les prochaines années en Inde et en Indonésie, où il est prévu que le nombre de climatiseurs en service soit multiplié respectivement par quinze et huit entre aujourd’hui et 2040. D’après l’AIE (Agence internationale de l’énergie), le nombre de climatiseurs dans le monde va croître nettement dans les prochaines années, pour dépasser les 4 milliards d’unités vers 2040 et atteindre en 2050 les 5,6 milliards d’unités. Toutefois, il faut construire et distribuer ces machines, qui consomment de l’énergie et immanquablement polluent. Mais surtout, elles réchauffent à leur tour l’atmosphère ambiante, comme l’a montré Valéry Masson, chercheur à Météo France. Il précisait que, en cas de canicule sur Paris, l’utilisation de la climatisation pouvait faire augmenter la température de 2 °C.
Ainsi, pour résoudre les problèmes de surchauffe, on fait la promotion d’outils qui non seulement consomment de l’énergie, produisent des pollutions et des déchets, mais en plus ne font qu’accélérer les dysfonctionnements atmosphériques. Plus on a chaud, plus on se rafraîchit, plus on consomme et plus il fait chaud. Mais ce n’est le fait de personne. Le cercle vicieux est bien huilé, jusqu’au moment où toute la maison aura été détruite, et à ce moment-là on ne pourra plus chanter.
Point de vue 32 : Décembre 2022
Bien des éléments représentent des objets de convoitise, d’appropriation, engendrant immanquablement des phénomènes de concurrence et de rivalité. Pour leur part, les mers et les océans, qui représentent environ 71 % de la superficie du globe, semblent ne plus échapper à la règle de cet appétit vorace. Toutefois, loin des tensions territoriales maritimes, des combats autour des ressources halieutiques ou des activités d’extraction dans les profondeurs, je prendrai un exemple presque banal, mais dont les conséquences ne sont pas moins redoutables.
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre qui se déroule tous les quatre ans. Cette année, plus de cent trente bateaux étaient en compétition et environ 15 000 personnes étaient attendues pour cet événement. On sait que le sport est devenu une histoire de gros sous, et l’on s’éloigne de plus en plus de l’adage classique : « L’important, c’est de participer. » Dans notre cas, sponsors, publicitaires, marques diverses et variées, ou boutiques dédiées sont là pour montrer que l’argent est devenu un enjeu central, bien loin des seuls rêves de navigation et de grands espaces. Il serait aisé de prendre comme point d’appui le sport et ses dérives, mais à l’évidence un autre élément, plus équivoque encore, est à mettre en perspective et mérite qu’on s’y arrête.
Une polémique concernant la ligne de départ de cette course commence à émerger. Pour les plaisanciers qui circulent le long de la côte, l’accès reste pour l’instant gratuit. Or il n’en va pas de même pour les armateurs qui commercialisent des sorties et veulent être autorisés à assister à ce départ. En effet, pour ces derniers, l’organisateur de la manifestation, OC Sport, demande un droit de péage de 25 euros par passager, et la préfecture maritime souhaite qu’ils aient un pavillon spécifique. Ainsi, d’un côté, il y a ceux qui pensent que cette taxe est indue, ils convoquent la libre circulation et le « bien commun » de l’océan. En attendant, ils profitent de cette manne financière pour promouvoir leurs activités lucratives. Ici, le bien commun semble avoir bon dos. De son côté, l’organisateur protège son exploitation commerciale de la course. Il invoque sa responsabilité et toutes les contraintes relevant de la logistique ou de la sécurité. Mais, via ce « péage », il s’approprie de fait pendant un laps de temps une zone maritime. Le constat paraît simple. Tout tourne une fois de plus autour des sacro-saints bénéfices qui peuvent être réalisés. La compétition économique apparaît dès lors encore plus féroce qu’entre les divers participants. Toutefois, pour que cela fonctionne et pour en arriver paradoxalement à ce que quelques-uns s’approprient et privatisent la mer pour leurs seuls intérêts, il faut qu’il y ait du public (spectateurs et consommateurs). À défaut, et si personne ne cautionnait ce type de manifestation, peut-être que la mer retrouverait sa valeur authentique de « bien commun »…
On sait que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis l’époque où, en droit romain, la mer et ses rivages étaient considérés comme des choses communes. Plus nettement, ils ne pouvaient faire l’objet d’une appropriation. Ils restaient hors du commerce et de l’argent. Tout cela semble de nos jours disparaître et même s’inverser radicalement. Pour ce qui est des rivages, on peut admettre que la messe est dite. En quelques décennies, ils ont été urbanisés, goudronnés et bétonnés. Plus crûment, ils ont été en grande partie massacrés (à grands coups de dérogations) et continuent de l’être (voir la Lettre ci-jointe). Il ne restait plus dès lors qu’à s’approprier la mer elle-même. Tout indique que nous nous dirigeons bien dans cette voie.
Point de vue 33 : Mars 2023
Une loi de 2004 a séparé l’exploitation et la maintenance du réseau de transport d’électricité français en instaurant une scission entre d’un côté EDF (Électricité de France) et de l’autre RTE (Réseau de transport d’électricité). À la fin de l’année 2022, RTE a mis en place un dispositif appelé « écowatt » qui se veut la « météo de l’électricité pour une consommation plus responsable ». Pour cela, une application mobile permet de recevoir directement sur son smartphone une notification. Dès lors, il est possible de savoir, en temps réel, si la consommation dans l’Hexagone est élevée, de connaître les écogestes à adapter et de s’abonner à une alerte coupure. Pourtant, au-delà de ce terme « éco » qui, de nos jours, est employé à bien des sauces (écoconstruction, écotourisme, écocitoyen, écoresponsable, et l’on en passe), voilà une initiative de télécommunication qui pose quelques interrogations.
On considère généralement que la consommation électrique d’un téléphone mobile et particulièrement d’un smartphone est très faible, voire presque nulle. À première vue, cela semble exact, puisque ce type d’appareil ne consomme en soi qu’environ 3,5 kWh par an pour un coût total de 4,5 euros. Une ampoule allumée semble être beaucoup plus gourmande en énergie. Sauf que ces simples données relèvent d’illusions, voire d’inexactitudes. Ainsi, comme le relevait Alain Gras, dans son livre Le Choix du feu, il existe une « nouvelle forme d’hypocrisie sociale, celle du camouflage des effets pervers du développement technologique ». Il faut alors revenir sur quelques détails.
En 2021, 95 % de la population française de plus de 15 ans disposaient d’un téléphone portable et 77 % possédaient un smartphone. Ce dernier pourcentage, qui n’est en rien négligeable, correspond à environ 40 millions d’utilisateurs. Imaginons que tous se servent de leur appareil au même moment pour consulter les multiples applications qui existent, et notamment « écowatt ». Il en résulterait des effets cumulatifs assez significatifs, car il ne suffit pas d’entrevoir la seule consommation du portable lui-même. Il est nécessaire de tenir compte aussi de tout un système qui permet de le faire fonctionner. D’une part, il ne faut pas oublier la production globale d’énergie (wifi et Internet) qui est nécessaire. En effet, un smartphone n’est utile (et utilisable) que s’il existe d’immenses réseaux de télécommunication et d’électricité, mais aussi des serveurs qui tournent à plein régime vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans des salles spéciales climatisées (pour ce type d’installation, l’énergie dévolue représente environ 3 % de la consommation mondiale). En définitive, un smartphone consomme réellement 388 kWh par an, ce qui s’avère plus important, par comparaison, qu’un réfrigérateur avec ses 322 kWh. D’autre part, il faut rappeler que ces appareils sont changés, en moyenne, tous les deux ans, via une industrie gloutonne et polluante, tant pour leur production que pour les déchets qu’ils génèrent. D’ailleurs, une étude de Greenpeace montrait que, pour fabriquer les sept milliards d’appareils mobiles en service dans le monde, l’industrie a consommé 968 milliards de kWh, ce qui correspond à la consommation électrique d’un pays comme la Belgique sur une période de onze années.
En définitive, on se retrouve face à un curieux paradoxe. Par l’intermédiaire de ces divers appareils de communication, on souhaite réduire la consommation énergétique tout en consommant plus d’énergie. Pour le dire d’une tout autre manière, et par analogie, c’est un serpent qui se mord la queue, mais qui est aussi en passe de se dévorer totalement.
Point de vue 34 : Juin 2023
Il y a à peine un siècle, les espèces sauvages occupaient environ 85 % de la superficie de la Terre. Aujourd’hui, cette part n’est plus que de 23 %, et l’on peut prédire sans risque que d’ici quelques années elle aura quasiment disparu. Toutefois, un autre problème est à relever.
La réduction des espaces naturels peut être considérée comme la principale cause de la disparition d’espèces animales sauvages. Ces espaces vitaux ont été grignotés par une urbanisation galopante, avec son lot de lotissements et de routes, par une déforestation effrénée, une bétonisation des zones humides et une surexploitation des terres agricoles. Les milieux originels s’étant appauvris, de nombreuses espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’autres animaux sont menacées d’extinction. Dans ces conditions, cette faune se retrouve en quête de nouveaux espaces de vie et de ressources, lorsqu’elle n’est pas totalement encerclée. La pérégrination s’opère vers des zones agricoles ou d’élevage, mais aussi vers des territoires urbains. C’est ainsi que l’on peut parfois apercevoir dans de grandes métropoles des léopards, des ours, des ratons-laveurs, des renards, des lynx ou des babouins qui auparavant ne s’y aventuraient pas. Une étude américaine, dans la région des Grands Lacs, montre d’ailleurs que les animaux sauvages sont de plus en plus dépendants de l’activité humaine, qui représente 50 % de leur alimentation. Du simple fait des raréfactions spatiale et alimentaire, il semble logique que ces animaux en arrivent à s’attaquer aux élevages, ou maraudent dans des parcelles cultivées. Ceux qui se déplacent vers des endroits habités fouillent dans les poubelles débordant sur les trottoirs ou dans des décharges à ciel ouvert.
Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là et, pour ces espèces, c’est la double peine. Non seulement elles manquent de ressources, mais elles sont de plus présentées comme une véritable gêne pour l’activité humaine. Je prendrai ici quelques exemples spécifiques à la France. En 2018, le préfet de Saône-et-Loire appelle les chasseurs à se mobiliser pour tuer, sans restriction de tir, « beaucoup plus de sangliers » et réduire « de manière significative ces populations ». Il répond à la FNSEA qui dénonce des millions de dégâts. En 2021, le préfet de Seine-Maritime envisage la destruction de 1 430 renards. En 2022, ce même préfet renouvelle son arrêté pour 850 renards. Les raisons invoquées sont la prédation de petit gibier, le risque de propagation de maladies, mais surtout la protection des élevages avicoles. Toujours en 2022, le préfet de Lozère affirme : « Soyez assurés que mon objectif est bien d’éliminer les loups. » Ces propos renvoient à une manifestation à Mende dont le slogan est « Loups : une seule solution, l’extermination ». Au début de l’année 2023, la Nouvelle-Calédonie réalise une campagne d’abattage de 18 requins à la suite d’accidents. La maire de Nouméa affirme d’ailleurs : « Il n’y a pas d’autre solution. » Cependant, au-delà de la puissance publique, il faut considérer nombre de comportements individuels tout aussi préjudiciables. Certains résidents détruisent des nids d’hirondelles lorsque leurs terrasses sont souillées. D’autres suppriment des habitats de chauves-souris, quand d’autres encore font pression pour délocaliser les grenouilles d’une mare. Un ami m’a même parlé de la liquidation pure et simple de canards, aux abords de lacs artificiels destinés aux loisirs, qui sont enfermés et étouffés dans des sacs-poubelle.
On sait que toutes les espèces animales ont un instinct de survie. Mais l’homme a, semble-t-il, ajouté l’instinct de mort. Il a réussi à éliminer la plupart de ses prédateurs et est prêt à exterminer toutes les autres espèces qu’il nomme « proliférantes ». Il ne reste plus qu’à inscrire dans la loi la notion de légitime défense face à une bête sauvage…
Point de vue 35 : Septembre 2023
Je prendrai ici un exemple tiré de la vie quotidienne. J’ai l’habitude de me promener le long d’une rivière limitrophe d’une ville moyenne. Il y a quelque temps encore, il n’y avait ici qu’un petit layon entouré de broussailles que l’on pouvait suivre. Seules quelques personnes y venaient. Toutefois, depuis peu, j’ai pu constater les aménagements qui ont été réalisés mais surtout leurs effets. Les résultats qui suivent n’ont, à vrai dire, rien d’exceptionnel, mais posent quelques problèmes dans un monde très individualisé.
Comme cela se fait dans toutes les zones urbaines, et bien entendu par imitation systématique, ce sentier a été transformé, pour ne pas dire transfiguré. Il a été élargi, aplani, recouvert d’un matériau concassé. Ses abords sont très régulièrement tondus. Ce n’est plus un chemin puisqu’il a pris la dénomination plus noble de « voie verte », destinée aux piétons et aux vélos. Dans le langage actuel, il représente un lieu convivial, plutôt affecté aux loisirs et à la mobilité « douce ». C’est ce qu’on appelle un « espace partagé ». Cela suppose donc que toutes les personnes qui s’y trouvent ont globalement les mêmes appétences, voire les mêmes conduites. Or que se passe-t-il en réalité ?
À l’évidence, cela ne va pas de soi. En effet, les personnes estiment toutes cette voie de manière fort différente. Pour simplifier, deux modes de déplacement s’y côtoient. Il y a d’une part les gens qui flânent à pied et d’autre part ceux qui utilisent cette voie comme une simple artère de circulation. Les vitesses de déplacement ne sont donc pas similaires. Ainsi, cet espace est devenu, assez rapidement, potentiellement conflictuel à bon ou mauvais escient, voire aussi source d’accrochages et d’accidents. Dès lors, les piétons protestent contre ceux qui utilisent leurs vélos ou leurs trottinettes et disent qu’ils vont trop vite. Mais ceux qui sont à vélo grognent contre les marcheurs, et plus nettement contre ceux dont les chiens, prétendent-ils, prennent toute la place. Si l’on raisonnait alors par l’absurde, pourquoi ne pas décomposer cette voie en plusieurs pistes, une pour les vélos, une pour les trottinettes, une autre pour les patins à roulettes, et une autre encore pour les promeneurs (ceux avec chien et ceux sans chien) ? Ce découpage pourrait alors se réaliser à l’infini, pour que chacun puisse avoir sa propre voie de circulation et faire ce qu’il souhaite. Les adultes pourraient en prendre une, les autres seraient pour les enfants ou pour les vieillards. Plus insensé, il pourrait y avoir celle pour les femmes et celle pour les hommes. Mais alors, l’idée de partage ne volerait-elle pas en éclats ?
Tout cela signifie que si ce mot de « partage » se trouve aujourd’hui bien souvent convoqué, c’est qu’il met en avant une espèce d’image du « commun ». Cela va du partage d’informations, de données, de renseignements ou de liens numériques, en passant par les espaces partagés (ou tiers-lieux), le travail partagé, le logement partagé, les jardins partagés, pour en arriver aux repas partagés, et j’en passe. Dans ce cadre, on pense qu’en brandissant ce terme tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais cela est-il si évident ? Suffit-il d’invoquer le mot « partage » pour faire advenir un univers idéal ? On peut sérieusement en douter.
Partager un repas semble assez simple, mais partager l’espace public devient certainement beaucoup plus compliqué. En définitive, on a l’impression que, plus on parle de partage et de mise en commun, plus on en arrive à un partage qui trace le chemin plutôt vers la partition ou la séparation.
Point de vue 36 : Décembre 2023
En consultant les informations de l’AFP, j’ai retenu une phrase du gouverneur de Floride Ron DeSantis, futur candidat aux élections présidentielles des USA. Celui-ci affirmait en mai 2023 : « Je m’engage à être un dirigeant énergique qui s’attaquera aux questions importantes. » Il serait amusant de tourner cette phrase à l’envers. Il aurait pu dire qu’il ne s’engagerait d’aucune manière et ne se chargerait que de questions insignifiantes. A contrario, en France, on prétend se défendre de ce style de raisonnement, et les femmes ou les hommes politiques de tous bords préfèrent le « parler vrai ». Prenons l’exemple de cet élu français qui, en juin 2023, expliquait sa position dans un journal régional de la façon suivante : « Nous avons fait le choix de nous positionner dans le seul cadre de l’intérêt de la population, loin de l’opposition stérile. C’est la raison pour laquelle nous accompagnerons favorablement les mesures qui nous semblent aller dans le bon sens. » Une fois encore, on aurait été assez surpris s’il avait admis qu’il ne se positionnerait que dans son seul intérêt et ne prendrait que des mesures allant dans le mauvais sens.
Cela dit, toutes ces déclarations ne sont-elles pas bien calculées ? Elles ne portent préjudice à personne, restent simples et a priori accessibles à tout un chacun. On peut dire que ce type de langage ne relève pas d’une espèce de langue sibylline ou obscure. Ou alors il faudrait admettre que son sens ultime en resterait caché, et ces phrases ne seraient destinées qu’à la compréhension, au décryptage de quelques adeptes ou disciples admis dans le secret. Pourquoi pas ? Ou alors il s’agirait d’une langue subliminale, qui serait codifiée par quelques officines de publicité et de communication. Dans ce cas, l’objectif ultime serait de vendre une simple image. Pour preuve, lors du grand-marché-des-élections, la foule se presse aux urnes. À tout cela, on pourrait adjoindre bien d’autres possibilités. En réalité, les phrases citées sonnent assez creux, et celui ou celle qui serait un tout petit peu attentif et loin d’être dupe n’y verrait bien évidemment qu’un langage de propagande. En d’autres termes, un langage correctement ciblé pour une opinion publique avide de mots ou de sentiments plaisants.
On pourrait finalement traduire ces positionnements par ce que l’on nomme couramment la « langue de bois ». Cependant, dans les exemples précédents, aucun ne renvoie ni à l’idéologie d’un organe officiel ni à une quelconque forme d’endoctrinement d’État. En définitive, je pencherais plutôt vers ce que François-Bernard Huyghe appelait la « langue de coton ». Sans reprendre l’ensemble de ses arguments, celle-ci est construite sur des messages vagues, mais qui sont avant tout ouatés. Si le principe reste toujours d’influencer les populations, l’important est surtout de les endormir, de les amollir et de ne pas les fâcher. Le proverbe « qui dort dîne » est dès lors remplacé par « qui dîne dort ». L’auditoire est ainsi anesthésié pour deux raisons. L’une permet au personnel politique de se protéger et d’éviter ainsi que d’autres ne prennent la parole, que cela soit au niveau national ou local. Attitude cependant très surprenante dans une démocratie. L’autre raison est là pour faire ingurgiter des formules vides, comme par exemple « bien vivre ensemble ». Ou alors pour faire passer des slogans ineptes, comme dans le cas de la sécheresse, lorsque le journal d’un conseil régional titrait : L’eau : il est urgent d’agir, alors que le problème est prégnant et récurrent depuis des décennies.
Mais il y a alors un souci. À force d’émettre des formulations insipides, le risque n’est-il pas de laisser le champ libre aux pires argumentaires ?
Point de vue 37 : Mars 2024
L’aménagement du territoire en France pose de nombreux problèmes et interrogations. Entre 1945 et 1975, 8 700 000 logements dans de grands ensembles ont été construits « vite et à moindre coût ». Or, dès 1956, le groupe d’experts « Économie et humanisme » donnait l’alerte sur les risques sous-jacents (difficultés d’animation, transformation anarchique de l’espace, risques de ghettoïsation, problèmes de délinquance et d’échec scolaire). Depuis les années 1970 jusqu’à 2010, la périurbanisation a dévoré 2,5 millions d’hectares dans l’Hexagone. En 1994, le géographe Jacques Lévy critiquait l’« espace peuplé de pavillons péri-urbains », rongeant des territoires entiers. Deux décennies plus tard, aucune modification n’était constatée. L’architecte Cristina Conrad écrivait en 2006 dans une tribune : « La France est aujourd’hui de plus en plus défigurée sur l’ensemble du territoire, ... des lotissements, des pavillons se multiplient à l’infini », avec des incidences environnementales et humaines. Ainsi, les années passent, les critiques sont récurrentes, mais la tendance reste identique. Même la loi récente « Climat et résilience », du 22 août 2021, repousse à 2050 l’arrêt du phénomène.
Dès lors, je prendrai simplement le cas du département des Pyrénées-Orientales, qui a déjà massacré son environnement et continue de le faire. En effet, les orientations prises par le SCoT (regroupant 77 communes) semblent du même acabit. Son programme est de favoriser la construction d’environ 35 000 logements à l’orée de 2038. Si 30 % de ces habitations seront réalisées à l’intérieur de zones déjà bâties, 70 % d’entre elles se feront à l’extérieur de celles-ci. Ce projet a été élaboré en tenant compte du seul indicateur de prévision, celui d’une augmentation de la population de 0,7 % par an. Toutefois, plusieurs éléments auraient dû dissuader les décideurs. On sait que l’Occitanie est la région la mieux dotée en résidences secondaires Insee (501 000), soit 13,5 % de son parc en 2017. Les P-O en disposent de 86 000, ce qui n’est pas négligeable. Alors, quelle sera la destination des logements futurs ? Un autre facteur vient s’ajouter au précédent, celui de la pénurie d’eau. Depuis 2021, la sécheresse y est notoire, elle est liée à la géographie des lieux et au changement climatique. Dans ces conditions, peut-on envisager de construire toujours plus ? Encore une fois, rien ne change. Même les avis de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) qui portent sur ces deux points semblent rejetés. Le président du SCoT insiste d’ailleurs lors d’un entretien : « Nous n’avons pas la même vision du territoire. ... La MRAe a une vision déconnectée de la réalité du territoire et de la volonté des élus. » Mais de quelle réalité du territoire et de quelle volonté parle-t-il ?
Au-delà de l’aveuglement apparent, je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi les élus sont si friands de ce mot « territoire ». Pourquoi le mettent-ils autant en avant, alors que, par petites touches, ils le détruisent irrémédiablement ? Ne le brandissent-ils pas comme un leurre, défendant en définitive d’autres intérêts ? En effet, ils paraissent beaucoup plus avides de maintenir leurs clientèles composées de promoteurs, d’agences immobilières, de notaires, d’entreprises du bâtiment ou de propriétaires fonciers, souhaitant ardemment passer leurs lots de terre en constructible. Tous, bien évidemment, profiteront de cette manne et remercieront les décideurs. Ainsi, lorsque le président du SCoT affirme : « On n’a pas le choix », ne fait-il pas preuve d’une bonne dose de mauvaise foi ?